Dernière publication :
mercredi 15 avril 2015
Rechercher
par mot-clé
par index

Interview Laurent Chalumeau
par Thibault le 9 février 2011




C’était le 4 novembre dernier. Il se tenait une « rencontre rock & littérature » à laquelle on s’est rendu par désœuvrement mêlé de curiosité, et aussi, il faut bien l’avouer, avec l’envie de s’en payer en bonne tranche en écoutant les gémissements du pantin de rien Patrick Eudeline, qui sur le papier figurait parmi les intervenants ce soir là. Au final, rien de tout ça. Patou s’est fait porter pâle en ressortant le coup de l’OD backstage avant l’heure, et l’épiphanie nous est parvenue avec la découverte de Laurent Chalumeau.
En deux prises de paroles, l’ancien de Nulle Part Ailleurs avait réglé son compte au débat et disait en substance et avec la manière une bonne partie des choses qu’on maugréait dans son coin depuis quelques temps. Notamment qu’avant de penser à « écrire rock », ce qui ne veut décidément rien dire, il fallait songer à traiter son sujet avec sérieux. Une lecture par l’animateur de quelques pages de son livre Moi & Bobby McGee finissait de nous séduire, il fallait regarder ça de plus près.
On s’est donc enfilé avec plaisir Moi & Bobby McGee et sa centaine de pages qui scanne en long, en large et en travers la chanson de Kristofferson et tous les électrons qui gravitent autour. Puis En Amérique, recueil d’articles publiés dans L’Écho des Savanes et R&F au cours des années 80, où l’on y parle aussi bien de Monument Valley et de radio locale émettant depuis un pénitencier que d’Ice-T. Ô joie, point de Gloubi-boulga gonzoïde babouinesque recherchant le frisson sensationnaliste du reportage de terrain mais des articles chiadés, épurés, secs, souvent très drôles. Au détour d’un chapitre, Chalumeau dit des bonnes chansons country qu’elles sont d’un « laconisme viril », c’est la même âpreté au cordeau qu’on retrouve dans ses pages.
Autant de raisons pour en discuter directement avec l’intéressé.
Inside Rock : La première chose qui m’a frappée en vous lisant, c’est un ton et un point de vue assez singulier. Vous n’êtes ni distant ni cynique avec votre sujet mais pas complaisant pour autant. Vous avez déclaré dans une autre interview que « Les mythes, c’est rusé : ils ne le deviennent pas par hasard. Donc, c’est intéressant d’en soulever le capot, d’aller voir derrière, comment ça marche, comment c’est fait, sur quoi ça repose. Le proverbe dit : « Si tu veux perdre la foi, va à Rome ». Mon expérience, c’est qu’une fois à Rome (ou à Memphis, à New Orleans ou Chicago), on ne perd pas la foi, on la nuance et on la reformule. On croit peut-être à moins de trucs qu’avant de venir, mais on est plus convaincu de ceux qu’on garde » Finalement, c’est en démystifiant un mythe qu’on sait s’il est véritable ?
Laurent Chalumeau : Il y a une part d’épreuve du feu immanquable, mécanique et involontaire dans la confrontation face à une réalité dont on a rêvé. Ce n’est pas pour se parer des plumes du paon ou s’arroger une quelconque autorité mais quand on arrive dans des endroits dont on ne connaissait que des représentations dans des chansons, au cinéma ou dans des bouquins, qu’on s’en est fait une certaine idée et qu’on découvre leur réalité, il y a parfois des endroits identiques à ce qu’on imaginait, des endroits décevants, d’autres réservent de bonnes surprises. La surprise étant souvent de voir que ce qui en fait l’intérêt n’est pas forcément ce qu’on avait envisagé dans un premier temps.
Je prends l’exemple de New Orleans par exemple, pré Katrina évidemment. Tant qu’on y est pas allé, on a un fantasme qui ressemble au pire des pièges à touristes de la pire des rues du « French Quarter ». Une fois qu’on y est, on s’aperçoit que ça se passe pas forcément dans ce fameux quartier et que c’est encore mieux à tous les étages que ce qu’on s’y imaginait en termes de musique, de sensualité, d’épices dans la nourriture, tous les trucs associés à la Nouvelle Orléans. Ils existent mais pas exactement là où on les plaçait, pas exactement comme on les imaginait...
IR : Pardon de vous couper, mais avez vous vu la série Treme sur cette ville ?
LC : Non mais j’ai hâte de la voir, je fais partie des admirateurs, des adorateurs de David Simon depuis la diffusion du premier épisode de The Wire sur Canal Jimmy derrière The Sopranos il y a de ça six ans ! [1] Ça a été un éblouissant immédiat. La bonne nouvelle est que souvent la mythologie résiste à la présence réelle dès lors que ses mythes ne sont pas là par hasard, de façon arbitraire. Il y a toujours un étalon or qui vient les garantir.
Ce n’est pas méthodologique, ni délibéré, d’autant qu’en ce qui me concerne, quand j’ai eu l’occasion de me mettre en face des idées que je m’étais faites, ma posture n’était pas du tout celle du vérificateur, c’était plutôt celle du pèlerin. C’est une question de tournure d’esprit, je pars du principe que qui aime bien persifle bien. Je n’ai jamais trouvé la bonne façon de faire concurrence à Beaumarchais mais « sans la liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur », je trouve que c’est encore plus vrai si on trouve un bon moyen d’inverser la proposition. Sans éloge, le persiflage n’a point droit de cité, on ne peut pas être uniquement dans la démolition ou dans le ricanement mais à l’inverse une posture de pèlerin extasié s’essouffle.
IR : Contrairement à beaucoup de commentateurs de culture populaire, vous ne semblez pas vouloir paraitre lettré ou en mettre plein la vue.
 LC : Oh oh ! Attendez ! En Amérique c’est un florilège constitué de hautes luttes et à grande peine ! C’est la crème de la crème mais ce qu’il a en dessous et autour n’est pas que du petit lait ! Toutes les grimaces, simagrées, poses et postures folkloriques et rituelles de la rock-critic rock-critiquante je les ai toutes eues, pratiquées et poussées jusqu’à un paroxysme suffocant ! J’ai réussi à me lasser moi même de toutes ces singeries, je me suis dit un matin que ça allait dans le mur de manière inintéressante. J’ai pris mon sujet, mon travail et mon lecteur au sérieux au lieu de ne voir dans les sujets que des prétextes à un numéro de claquettes auto-valorisant.
LC : Oh oh ! Attendez ! En Amérique c’est un florilège constitué de hautes luttes et à grande peine ! C’est la crème de la crème mais ce qu’il a en dessous et autour n’est pas que du petit lait ! Toutes les grimaces, simagrées, poses et postures folkloriques et rituelles de la rock-critic rock-critiquante je les ai toutes eues, pratiquées et poussées jusqu’à un paroxysme suffocant ! J’ai réussi à me lasser moi même de toutes ces singeries, je me suis dit un matin que ça allait dans le mur de manière inintéressante. J’ai pris mon sujet, mon travail et mon lecteur au sérieux au lieu de ne voir dans les sujets que des prétextes à un numéro de claquettes auto-valorisant.
Effectivement, ce qui constitue En Amérique et ce qui fait, ceci dit en toute modestie, que ça reste à peu près valide, pertinent et lisible vingt cinq ans après tient au fait que les articles ont été écrits pendant une espèce de parenthèse enchantée. C’est intervenu entre ma propre invention de la pilule et ma propre apparition du SIDA. L’invention de la pilule c’est cette prise de conscience d’arrêter de faire le malin juste pour le faire et de pousser la coquetterie du cancre jusqu’à croire qu’il y a une prime au non travail, à la paresse et à la désinvolture. C’est irrespectueux pour tout le monde et les premières victimes sont ma personne, mon envie d’écrire et mes ambitions. C’est une décision volontariste de pratiquer un peu plus d’humilité, de méthodes besogneuses. L’apparition du SIDA qui est venu sonner le glas de cette innocente ferveur, c’est d’être resté trop longtemps aux États Unis.
Pendant que moi, à force de voyages, de rencontres, de recherches, je commençais à approcher une certaine expertise du réacteur atomique des musiques et mythologies américaines, au même moment, j’en voyais l’abâtardissement proposé par l’industrie. On sortait des vieux bluesmen de l’hospice pour leur faire rejouer les mêmes vieux riffs éculés dans une pub pour soda en leur collant une espèce de blanc bec pour servir de passerelle avec les jeunes téléspectateurs de MTV, enfin bref. Toute cette espèce de barnum me navrait et m’amenait à nourrir une certaine aigreur, à prendre un ton blasé et à tirer sur tout ce qui bougeait ! Quand on est correspondant aux États Unis pour un journal musical, on est là pour faire rêver les gens. Tout comme mes ancêtres écoutaient Radio London, pour avoir lu les articles de Garnier en provenance des Etats Unis, on veut juste la bonne dose de démythification qui vient garantir la construction d’autres mythes ! 10% de regard critique pour 90% d’hagiographie. Les derniers mois de ma participation à Rock & Folk, j’étais arrivé à un très mauvais point dans la démolition méthodique avec un ton amer, à la lisière de l’aigreur, d’une mauvaise acidité, un peu pédante et prétentieuse.
Les articles d’En Amérique se sont faufilés entre le moment où je branlais rien, quand je pensais qu’il suffisait de raconter trois mauvaises plaisanteries ou ce qui précédait l’interview pour faire un bon article, et le moment où les bras me sont tombés en me disant que décidément, ce qu’il y avait de céleste, de magique et sacré, au sens laïc du terme, dans les musiques américaines serait quoiqu’il arrive trahi, maltraité et dénaturé par l’industrie. Le ton qui vous a plu est une espèce d’accident.
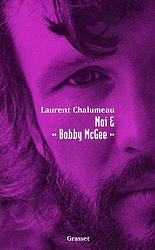 IR : Vous vous décrivez parfois comme un « mythomane », au sens de quelqu’un qui veut raconter des histoires. On ressent cette envie de différentes manières dans En Amérique et Moi & Bobby McGee, un côté plus documentaire, l’autre plus digressif, mais qui se rejoignent dans une certaine rigueur, avec l’attachement au texte, à des lieux, des informations précises. Moi & Bobby McGee c’est en quelque sorte un travail de connexion entre différents éléments réels ou fictifs contenus ou évoqués par la chanson.
IR : Vous vous décrivez parfois comme un « mythomane », au sens de quelqu’un qui veut raconter des histoires. On ressent cette envie de différentes manières dans En Amérique et Moi & Bobby McGee, un côté plus documentaire, l’autre plus digressif, mais qui se rejoignent dans une certaine rigueur, avec l’attachement au texte, à des lieux, des informations précises. Moi & Bobby McGee c’est en quelque sorte un travail de connexion entre différents éléments réels ou fictifs contenus ou évoqués par la chanson.
LC : En ce qui concerne Moi & Bobby McGee, le livre lui même est une suite d’accidents. J’étais parti pour rajouter dix feuillets pour un inédit dans un recueil d’articles et en fait j’en avais écris quarante juste en traduisant et commentant le texte de la chanson sans aucun repère biographique, ni aucune mise en perspective. Du coup je me suis retrouvé avec une espèce de monstre que mes éditeurs m’ont poussé à sortir à part. L’écriture de ce livre a été une divine surprise, c’est comme un hamster qui se remplit les bajoues puis se les vide. Ça prend tout le monde par surprise, on pouvait pas imaginer que des joues de hamster contiennent autant de saloperies ! C’est éventuellement la preuve que je n’ai pas fait entièrement fausse route en pensant que cette chanson était charnière et porteuse de plus que ses simples couplets, refrains et mélodies.
C’est une chanson étonnante, elle me fait l’effet de bien rassembler beaucoup de choses qui l’ont précédée et d’avoir eu une descendance du fait de son succès anglo saxon. Pour en dresser l’inventaire, on se retrouve avec cent pages. J’en étais le premier étonné !
IR : Parmi la descendance de cette chanson, j’ai été étonné de voir à quel point la description que vous faites de Bobby (dans la version où Bobby est une fille) colle au portrait du personnage de Jenny dans Forrest Gump.
LC : Ah oui, peut être bien. La figure de la fille de fermier fugueuse n’a évidemment pas été initiée par Kris Kristofferson. Comme Forrest Gump est aussi, pour d’autres raisons et avec un autre projet en tête, une espèce d’alignement de clichés un peu subvertis et piégés, ce n’est pas pour rien qu’on tombe sur une telle coïncidence.
IR : Cette chanson est un cross-over qui touche aussi bien le public hippie que redneck. Voyez vous d’autres chansons qui ont réussi ?
LC : Il y en a forcément, il faudrait prendre les charts de l’époque. Deux ou trois ans après la sortie de Me & Bobby McGee, il y a Willie Nelson, le mouvement outlaw, où les Eagles a leur façon. Mais ce qui fait la particularité de notre chanson, c’est que c’est en 1969, en même temps qu’Easy Rider, donc une période où au moins dans l’imaginaire, si ce n’est pas dans la réalité, les plus raides des rednecks n’hésitaient pas à vider un fusil de chasse à canon scié dans la gueule d’un gars dont ils trouvaient les cheveux trop longs. Les portes-paroles en présence étaient symboliquement forts, une chanson chantée à la fois par Janis Joplin et Jerry Lee Lewis, ce n’était pas gagné.
IR : A propos de chanson de redneck, pouvez vous nous parler de cette incroyable chanson de Merle Haggard, Okie From Muskogee ?
LC : Que dire ? C’est une chanson drôle, incroyablement bien écrite, représentative du caractère et de l’univers de Merle Haggard, une espèce de Michel Sardou grognon. Si on remet la chanson dans son contexte, la vigueur, la radicalité des antagonismes et du feu sur lequel elle vient mettre de l’huile, c’est l’équivalent de Si Les Ricains N’Étaient Pas Là, Je Suis Pour, ces espèces de brèves du comptoir, de philosophie du café du commerce, du bon sens près de chez vous mis en musique. Sauf que là, la chanson est super bien branlée, super bien chantée, au quarantedouzième degré on s’en fout, on n’est plus ni hippie ni redneck. Il a récidivé plus tard avec une chanson moins légère et pince sans rire dans l’expression, The Fighting Side of Me, mais c’était déjà beaucoup plus chauvino-réac.
Quarante ans plus tard, c’est facile pour nous de prendre ça de haut et de renvoyer tout le monde dos à dos. Mais on pouvait aussi concevoir que les vrais gens du pays réel connaissaient des sursauts d’impatience et d’exaspération envers la façon dont ils étaient envisagés, traités et évoqués par les milieux qui s’autorisent, bien-pensants et proto-bobo de l’époque. Votre question ouvre sur quelque chose d’intéressant dans la musique country, quand celle ci est appréciée après coup et par des gens qui n’en sont pas les destinataires cœur de cible ; dans quelle mesure la différence entre les valeurs apparemment portées par telle ou telle chanson country et celles qu’on peut respecter, défendre spontanément et au plus profond de soi participe au plaisir coupable qu’on va prendre à s’encanailler l’esprit à écouter des chansons clairement plus réacs, bordeline facho ? Je pose la question sans y répondre. C’est forcément un frisson, on joue à se faire peur d’un point de vue idéologique en écoutant Stand By Your Man, Okie From Muskogee ou Beer For My Horses de Toby Keith.
[NDLR : Beer For My Horses, sorte de vigilante-song dont les bons mots feraient passer Clint Eastwood pour une pucelle effarouchée abonnée à Télérama :
Grandpappy told my pappy, back in my day, son /
A man had to answer for the wicked that he done /
Take all the rope in Texas /
Find a tall oak tree, round up all of them bad boys /
Hang them high in the street for all the people to see thatJustice is the one thing you should always find /
You got to saddle up your boys /
You got to draw a hard line /
When the gun smoke settles we’ll sing a victory tune /
We’ll all meet back at the local saloon /
We’ll raise up our glasses against evil forces /
Singing whiskey for my men, beer for my horses
Et ceci en 2002, farpaitement môssieur !]
Une autre question que ça pose est celle de l’équivalent français de cette revendication d’un droit à l’expression d’une certaine couche et catégorie sociale aux États Unis. Ça parait légitime, folklorique et pittoresque en Amérique mais si c’est français, c’est ringard, facho et vichyste. La mayonnaise est mal branlée.
IR : L’herbe est toujours plus verte chez le voisin, on ira facilement considérer Merle Haggard comme un bon bougre peu décrotté alors que Sardou est une terreur et une atteinte à la démocratie.
LC : Oui, ou Daniel Guichard, c’est assez voisin à bien des égards. L’autre commentaire qu’on peut faire, c’est qu’on ne fait pas de bonne littérature ni de bonne musique populaire avec de bons sentiments. Une fois que la poussière retombe sur les polémiques et grands problèmes de l’heure, peu importe ce que racontent les chansons ou pour qui votaient les interprètes. Ce qui compte : est-ce une bonne chanson ou pas ?
IR : Et il y a une dimension catharsique, ce n’est pas parce que des rednecks écoutent Merle Haggard qu’ils vont dégommer des hippies comme dans Easy Rider. Exprimer leur ressentiment dans ces chansons peut même éviter ce genre d’extrêmes.

LC : Il y a une phrase de Johnny Cash, qui doit être dans l’interview reproduite dans En Amérique, à l’époque j’étais agité par ces questions et ces contradictions au fur et à mesure de ma découverte de la vraie country, pas la merde de la radio. Dans une de mes rencontres avec Cash, je lui parlais d’une compil faite en Angleterre, un tribute album uniquement par des jeunes artistes indés/alter-ce-que-vous-voulez. C’était le Cash pré Rick Rubin, puritain, chrétien et sur le banc, viré par son label. Je lui demandais grosso merdo quel public lui paraissait le plus approprié pour ses chansons, les jeunes qui privilégient l’aspect insoumis ou le public traditionnel, plan-plan, chrétien et patriote ? Il a eu cette formule : « certains comprennent mes chansons, d’autres les vivent ». Lequel des deux publics a préséance sur l’autre ?
C’est une chose d’être un esprit éclairé qui va s’encanailler la tête à rêver de pick-up trucks, de rodéo, de shot-guns, de petites sauvageonnes en robe de coton boutonnée sur le devant, enfin, toute l’imagerie. C’en est une autre de vivre dans les champs du Delta tous les jours que Dieu fait. Il y a des intellos urbains qui aiment bien les mythologies et l’arsenal imaginaire de la country et d’autres qui vivent ce que racontent ces chansons.
IR : Vous comparez Wilson Pickett au gangsta-rap. En y regardant de plus près, les bluesmen et les rappeurs ont le même comportement les uns envers les autres. Les premiers se renvoyaient la balle dans toutes les versions d’I Am A Man et de Mannish Boy pour savoir qui avait la plus grosse, pareil pour les rappeurs qui font ça d’une chanson à l’autre ou parfois dans la même chanson.
LC : Oui, c’est la même chanson. C’est pour ça que j’ai mis Ice-T au début d’En Amérique. En apparence c’était l’artiste le plus récent et en fait c’est lui qui conduisait les choses plus immémoriales, traditionnelles et éternelles. Le fondement de la culture noire, ce sont ces fameux dozens, ces joutes verbales qui ont d’abord été le fait des jazzmen de New Orleans. Même les 2pac et Notorious B.I.G. qui se canardent, c’est la reconstruction de Leadbelly. C’est du Stagger Lee. Si vous avez le courage, infligez vous Mystery Train de Greil Marcus ! La figure immémoriale du pimp, Robert Johnson qui signe au crossroads, Ike Turner, Wilson Pickett, maintenant ce serait Puff Daddy.
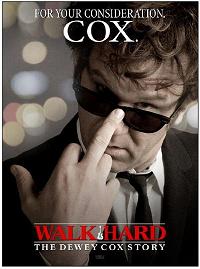 IR : Pour revenir à vos livres, cette manière de prendre des histoires pour en raconter d’autres avec esprit critique, humour et sans cynisme me fait penser à deux films, O’Brother et Walk Hard : The Dewey Cox Story.
IR : Pour revenir à vos livres, cette manière de prendre des histoires pour en raconter d’autres avec esprit critique, humour et sans cynisme me fait penser à deux films, O’Brother et Walk Hard : The Dewey Cox Story.
LC : J’ai vu et aimé les deux. Walk Hard, c’est exemplaire de cette tonalité espiègle, irrévérencieuse et en même temps respectueuse et prosternée. Ce qui dérouille le plus n’est pas tant les références du personnage que les références du film. Walk The Line ou Ray en prennent beaucoup plus pour leur grade que la figure de Johnny Cash. O’Brother c’est la même chose dans un autre domaine.
IR : Dans En Amérique vous racontez l’histoire de Claude Dallas, un jeune homme qui devient un meurtrier parce qu’il se croit dans un western. Ça me fait penser à un autre film des frères Coen, Fargo et ses personnages qui se prennent le réel dans la tronche parce qu’ils pensent être dans une fiction.
LC : Claude Dallas, c’est un croisement tragique et sordide entre Don Quichotte et Madame Bovary. Quand on se met à confondre le réel et le romanesque, dans des cas rarissimes, ça peut donner Bob Dylan. Le reste du temps, au moins mal, ça donne des mythomanes qui font la consternation de leur entourage. Au pire, ça donne des mythomanes qui entendent des voix qui leur disent de prendre un flingue. Encore plus pour les gens de ma génération, un petit garçon ne pouvait pas grandir sans avoir envie d’être un cow-boy. Il y a des gens à qui ça passe, d’autres non. Il faut que les mythomanies restent un plaisir, pas un métier ni une ligne de vie.
IR : Il y a un passage touchant dans le livre, après la rencontre avec le cavalier najaro, où vous évoquez le destin des civilisations condamnées et de légendes qui appartiennent définitivement au passé. C’est une question régulièrement posée ces temps ci, je pense encore une fois aux frères Coen et à No Country For Old Men. Quel est votre sentiment là dessus ?
LC : Vous me prenez un peu au dépourvu, je pense rarement en ces termes. Ces dernières années, je me suis émerveillé de la façon dont les répertoires, les magasins au sens de stocks et d’arrière boutique de l’imagination se renouvelaient. Je n’ai aucune dilection particulière pour les produits culturels japonais, c’est un truc de génération, de formation, d’habitude. Après un premier mouvement qui était de l’ordre de la réticence il y a vingt ans, car ce qui me parvenait était la nazerie de Dorothée, même un bourrin comme moi devait constater qu’une vie entière ne suffirait pas pour explorer tout ce qu’il y avait de riche, stimulant et provoquant là dedans. Je pense que si j’avais entre quinze et vingt-cinq ans aujourd’hui, mes références et horizons seraient sans doute moins américains et davantage tournés vers le manga que la bédé franco-belge.
Ces légendes, ces mythes et machins meurent et apparaissent sous une autre forme, en voyant la poussière commencer à s’amonceler sur certaines des choses auxquelles moi je tiens, je m’aperçois aussi qu’un vent vigoureux va gonfler les voiles d’autres choses. Je ne suis absolument pas prosélyte, je suis d’un sectarisme bonhomme, débonnaire et bienveillant, j’aime ce que j’aime, je trouve ça très bien que mes enfants écoutent autre chose que moi tout en communiant avec eux sur quelques repères irréfutables. Je suis réjouis de constater et d’entériner chaque jour ma propre ringardisation. C’est dans l’ordre des choses. J’ai plein de défauts, mais pas celui de jeunisme.
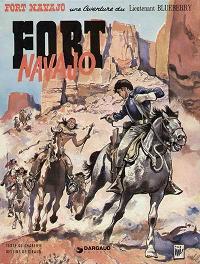 IR : Vous citez souvent Blueberry. Qu’est-ce que ça représente pour vous, y-a-t-il d’autres personnages ou figures qui vous ont marqué de cette manière ?
IR : Vous citez souvent Blueberry. Qu’est-ce que ça représente pour vous, y-a-t-il d’autres personnages ou figures qui vous ont marqué de cette manière ?
LC : C’est un truc d’enfance. Là encore, je ne vais rien dire de nouveau, mais ces trucs sont liés à l’enfance. Pourquoi j’aime certaines musiques américaines toujours blues based ? Soit de la soul du sud, du rockabilly, de la country, du blues hardcore, circonscrits dans une ou deux décennies qui encadrent ma naissance. J’ai du entendre, je sais pas où je sais pas quand, une note. Un peu comme le junkie recherche jusqu’à l’overdose la sensation de son premier fix, les disques que j’aime sont une envie de retrouver cette note. Je me demande en quelle mesure cette note est une bande originale, de film ou de feuilleton, mais clairement un western que j’aurais pu voir à la télévision.
Et je me souviens très très bien, alors que je devais avoir quatre ans, de la première fois où j’ai vu une planche de Blueberry. C’était dans un numéro de Pilote, une des planches du deuxième Blueberry. Ça m’a tenu longtemps, j’ai voulu être dessinateur de bande dessinée pendant les dix ans qui ont suivi, cette bande dessinée m’a renvoyé à d’autres, qui elles mêmes m’ont envoyé vers des films, c’est une sorte de pelote de laine. C’est un truc générationnel, vous trouverez un certain nombre d’hommes de mon âge pour qui Blueberry a été un choc esthétique et imaginatif.
IR : Vous avez déclaré que Proust vous a aidé à comprendre les Stones. Vous pouvez nous en dire plus ?
LC : La formule vaut ce qu’elle vaut. Il y a des pages dans À La Recherche Du Temps Perdu, au moins un tiers, de critique, de décorticage, non seulement d’œuvres, aussi bien de musique, d’arts plastiques avec le petit pan de mur jaune, de littérature mais surtout de décorticage des sensations. Voilà qui me parait plus innovant : pourquoi ça nous plait ? Pourquoi ça nous fait tel effet ? Une fois qu’on a réussi à se débarrasser de ces premières peaux, des simagrées et grimaces mondaines critiques dont je parlais tout à l’heure, les seules questions qui vaillent pour un critique sont pourquoi c’est bien, pourquoi ça marche, pourquoi ça nous fait l’effet d’être bien, comment ça marche à l’intérieur du moteur et comment ça réussit à nous emmener quelque part.
Forcément, il y a certaines solutions, certains outils qu’a fabriqué ou identifié Proust pour parler du ravissement dans lequel le plongeait l’écoute d’une mélodie que nous ne pouvons connaitre, ou telle phrase de tel auteur. Une fois mis en présence de cet outil, il marche aussi pour Hank Williams et pour tout. Dès lors qu’elle contient des informations et outils qui, à ma connaissance au jour d’aujourd’hui, ne sont encore disponibles que là, la lecture d’À La Recherche Du Temps Perdu est précieuse, même pour réussir à mettre un mot sur ce qu’on voit à l’œuvre et sur l’effet que ça fait à soi même. Mais on peut très bien vivre sans le faire, tout le monde n’est pas obligé d’être critique.
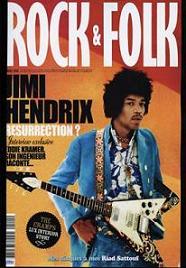 IR : Étant donné tout le bien que vous pensez de la rock critic et ses représentants qui capitalisent sur des anniversaires pour remettre en une Hendrix quarante ans plus tard en disant, une fois encore, que c’était lui qui jouait-d’une-guitare-comme-d’une-femme-avec-les-dents, est-ce que la critique musicale vous intéresse encore ?
IR : Étant donné tout le bien que vous pensez de la rock critic et ses représentants qui capitalisent sur des anniversaires pour remettre en une Hendrix quarante ans plus tard en disant, une fois encore, que c’était lui qui jouait-d’une-guitare-comme-d’une-femme-avec-les-dents, est-ce que la critique musicale vous intéresse encore ?
LC : Non. J’achète de temps en temps Rock & Folk quand je prends le train, de façon pavlovienne. Je suis toujours extrêmement client des facéties de Manœuvre, c’est un souvenir d’ado, un plaisir nostalgique. Il y a quand même des choses qu’on ne peut pas lui retirer, je mets au défi quiconque a commencé l’article de ne pas le finir, c’est un bon vendeur, et il me fait marrer. J’aime bien de temps en temps lire des articles de gens de ma génération quand ils en publient encore... Globalement je me fous de la presse rock.
Comment vous dire ça sans que ça fasse vieux con... Tant pis, il faut l’assumer. Rares sont les rock-critics, français ou anglo-saxons, qui me surprennent. Je me suis vraiment intéressé à la rock-critic, avant d’en faire j’avais envie d’en faire, et quand je me suis retrouvé à en faire j’ai beaucoup tâtonné, j’ai fait toutes les bêtises où deux ou trois recoins de soleil réussissaient à se faufiler. J’ai des lunettes rayons X, quand je commence un papier je vois les articulations, je vois les trucs et les ficelles.
IR : Le problème de la rock-critic, c’est que c’est un système de reconnaissance et de mots clés qui n’a pas de sens. Ce sont des signes très faciles à manipuler pour quelqu’un qui commence, j’en ai fait l’expérience quand j’ai commencé à m’y intéresser et gribouiller pas mal de merdes. En un an et demi de temps, une discothèque idéale et quelques lectures, on arrive très vite à s’y retrouver et ça donne l’illusion de faire quelque chose qui a du sens. Et on se retrouve avec des articles à lire en diagonale, une succession de mots clés creux.
LC : C’est ce que j’ai essayé d’épingler sans méchanceté dans la fausse interview du roadie dans En Amérique. Enfiler comme des perles tous les clichés sur les kids, l’intensité. Il y a une espèce de liturgie ressassée. Mais là encore, je ne vais pas dire du mal de choses que je ne lis pas, ça prouve que cette musique est intéressante ; des dizaines d’années après sa mort clinique prononcée, des vandales ouvrent sa sépulture, jouent au foot avec le cadavre et se trouvent des commentateurs sportifs pour raconter le match. Après tout, qui suis-je pour pleuvoir sur la parade de ces jeunes gens, qui partent à priori perdants puisque, sauf miracle qui n’est pas venu jusqu’à moi à présent, ils vont faire moins bien que les modèles qu’ils se sont désignés mais qui vont le faire quand même. C’est très bien que ça continue ainsi.
IR : Vous avez écrit des scénarios, notamment celui de Total Western. Est-ce que vous vous sentez proches des travaux actuels de personnes comme Alexandre Astier ou Michel Hazanavicius ?
LC : J’ai beaucoup d’admiration et de sympathie pour Michel Hazanavicius. J’ai fait des scénarios pendant quelques années, mais désormais je suis passé à autre chose, j’écris mes romans, ça me convient bien.
Merci à Laurent Chalumeau pour sa disponibilité et son amabilité.
[1] voir notre dossier sur ces séries
















Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
