Dernière publication :
mercredi 15 avril 2015
Rechercher
par mot-clé
par index

Placebo : Médicalement rock
par Psymanu le 28 mars 2006
Placebo fête cette année ses dix ans de carrière. À l’heure où paraît leur cinquième album, un petit bilan s’impose sur ces héros du rock indie devenus machine à déplacer des stades.




La genèse
Bruxelles, carrefour européen. 10 décembre 1972. C’est ici, et ce jour-là que naît Brian Molko, de parents Écossais (sa mère) et Américains (son père, lui-même mixé d’origines franco-italiennes). Un père dans la finance qui regrettera toujours que son fils n’ait jamais voulu l’y rejoindre, une mère croyante jusqu’au bout des ongles, elle aussi déçue de voir son rejeton tourner le dos à l’Église (il fut un « born-again Christian »). Un frère, aussi, de dix ans son aîné, un grand écart, trop important pour que s’instaure une réelle proximité de prime abord. Pas simple d’être le petit Molko, d’autant que ça implique d’être baladé : Malawi, Liberia, Liban, pour enfin poser ses valises au Luxembourg, en 1983. Ca fait voir du pays, c’est sûr, mais ça manque de stabilité et ça complique les amitiés en les condamnant au court terme.
 Et puis le Luxembourg, de l’aveu même de Brian, c’est chiant. Ca bouge peu, ça manque d’activité, ça a tendance à faire rester dans sa piaule à écouter de la musique. L’avenir ne pourra que l’en féliciter, mais pour l’heure il faut se distraire et sortir le nez dehors. De la musique, on lui en fait faire : le piano, que ses parents l’obligent à pratiquer. Un peu de saxo à l’école, mais rien de bien amusant, ni rien qui stimule suffisamment sa créativité pour l’inciter à y revenir. La guitare, en revanche, ça le branche davantage : il s’y met à 16 ans. Ca lui offre la liberté dont il avait besoin pour oser s’exprimer. Mais son truc à lui, c’est le théâtre. Il le pratique dès qu’il le peut, il s’y libère de ses frustration, y expérimente de nouveaux sentiments, de nouvelles stimulations, tout ce que sa vie de famille lui interdisait, implicitement ou non. D’ailleurs, c’est bien pour cette passion qu’il quitte en 1990 le giron familial. L’appel de Londres et du Goldsmith’s College, où il étudie plus profondément cet art dramatique dont jamais il ne se départira, finalement. Enfin il peut exploser, explorer, échappé des carcans luxembourgeois autant que de ceux de son propre entourage.
Et puis le Luxembourg, de l’aveu même de Brian, c’est chiant. Ca bouge peu, ça manque d’activité, ça a tendance à faire rester dans sa piaule à écouter de la musique. L’avenir ne pourra que l’en féliciter, mais pour l’heure il faut se distraire et sortir le nez dehors. De la musique, on lui en fait faire : le piano, que ses parents l’obligent à pratiquer. Un peu de saxo à l’école, mais rien de bien amusant, ni rien qui stimule suffisamment sa créativité pour l’inciter à y revenir. La guitare, en revanche, ça le branche davantage : il s’y met à 16 ans. Ca lui offre la liberté dont il avait besoin pour oser s’exprimer. Mais son truc à lui, c’est le théâtre. Il le pratique dès qu’il le peut, il s’y libère de ses frustration, y expérimente de nouveaux sentiments, de nouvelles stimulations, tout ce que sa vie de famille lui interdisait, implicitement ou non. D’ailleurs, c’est bien pour cette passion qu’il quitte en 1990 le giron familial. L’appel de Londres et du Goldsmith’s College, où il étudie plus profondément cet art dramatique dont jamais il ne se départira, finalement. Enfin il peut exploser, explorer, échappé des carcans luxembourgeois autant que de ceux de son propre entourage.
Toutefois, le virus de la musique, et plus particulièrement du rock’n’roll ne le lâche pas, et ne cesse de croître en lui. Il aime l’énergie du punk, quoi qu’il en refuse les clichés trop encombrants. Ce qui le branche, c’est la décharge émotionnelle et physique. Et puis l’époque s’y prête : les Pixies, Nirvana et le grunge naissant, les Sonic Youth également. Le rock semble vouloir retrouver ses fondamentaux en se départissant de tout le pompeux et le surproduit 80’s.
 Au bahut, Brian a une amie. Qui a un ami. Cet ami, c’est Steve Hewitt, qui a pour intérêt notable d’être un bon batteur. Lui, c’est un anglais pur et dur, made in Northwich mais élevé au grain et à l’asphalte de Manchester, étudiant brillant à la Wearchram High School. Un excellent complément du fantasque Molko :
Au bahut, Brian a une amie. Qui a un ami. Cet ami, c’est Steve Hewitt, qui a pour intérêt notable d’être un bon batteur. Lui, c’est un anglais pur et dur, made in Northwich mais élevé au grain et à l’asphalte de Manchester, étudiant brillant à la Wearchram High School. Un excellent complément du fantasque Molko :
« Steve est un gars du Nord, de Manchester, il ne faut pas lui en conter. C’est lui qui détient les clés de la réalité dans Placebo, qui me ramène sur terre. »
Mais pour l’heure, de Placebo il n’est pas question. Pas encore. Hewitt possède une expérience de groupe. Plusieurs, même, dont Breed, de façon irrégulière, et Boo Radleys. Il enregistre même un album avec ces derniers, intitulé Ishabod & I. Ses influences à lui, c’est davantage le hip-hop et le funk, presque logiquement : là où le rythme est plus fondamental. Sly and The Family Stone, Prince, James Brown, ou encore Public Enemy et les Beastie Boys, entre autres, bref ce qui se fait de meilleur dans chacune de ces spécialités. Au passage, il participe même à un projet dance intitulé K-Klass, car oui il aime bien la dance, et le disco aussi (Boney M, ces choses-là). La réalité le rattrape, sa nana tombe enceinte et il lui faut alors se mettre au boulot. Il les enchaîne sous diverses formes, comme conducteur de chariot par exemple, et voit ainsi s’éloigner sa passion. Mais celle-ci demeure la plus forte, il retourne se lover dans les bras de Breed. Ça marche plutôt très bien, d’ailleurs, puisque le groupe fait la première partie de Nick Cave deux ans durant. Parallèlement, lui et Molko fondent Ashtray Heart (référence à un titre de Captain Beefheart), que l’on peut considérer comme la première mouture de ce qui deviendra Placebo, et commencent à se produire dans des clubs.
 En 1994, survient l’autre tournant, quasi-mystique tant son improbabilité est absolue. Un matin, Brian Molko est dans le métro. Déjà, ça, c’est impossible, tant Molko est habitué à n’émerger que bien plus tard. Face à lui, une grande carcasse dégingandée, surmontée d’un visage qui lui semble immédiatement familier. Ce gars-là, c’est Stefan Olsdal, 20 ans, que Brian connaissait du Luxembourg, lorsqu’ils étaient à l’école américaine. Stefan est suédois (né à Göteborg), basketteur plutôt doué dans ses jeunes années, grâce à sa taille vertigineuse, mais qu’une rébellion à fleur de peau engage à suivre les chemins de traverse. Comme Molko à cette période, il vit de petits boulots mal payés. Sûr qu’une des premières questions à retentir fut : « Mais qu’est-ce que tu fous là, ici à Londres ? » En fait, après avoir poursuivi ses études en Suède, Olsdal a suivi ses parents dans la capitale anglaise afin de rejoindre le Musicians Institute. Car par un nouvel heureux hasard, il est musicien, lui aussi. Sauf que lui c’est plus sérieux : multi-instrumentiste (guitariste, pianiste, bassiste et batteur), il possède une parfaite connaissance théorique en totale opposition à l’autodidactisme approximatif de Brian. « C’est le genre de type qui, en marchant dans la rue, peut te dire sur quelles notes sonnent les différents klaxons des voitures. » précise ce dernier. Ses influences à lui, ça va du classique au heavy metal, surtout le heavy metal dans lequel il se jette, majeur tendu vers ses parents, même si son groupe préféré reste Depeche Mode. Il aime bien Abba, aussi, mais ça c’est son côté suédois (il reconnaît pouvoir pleurer à l’écoute de The Winner Takes It All, personne sauf lui-même ne peut dire s’il est sérieux ou pas).
En 1994, survient l’autre tournant, quasi-mystique tant son improbabilité est absolue. Un matin, Brian Molko est dans le métro. Déjà, ça, c’est impossible, tant Molko est habitué à n’émerger que bien plus tard. Face à lui, une grande carcasse dégingandée, surmontée d’un visage qui lui semble immédiatement familier. Ce gars-là, c’est Stefan Olsdal, 20 ans, que Brian connaissait du Luxembourg, lorsqu’ils étaient à l’école américaine. Stefan est suédois (né à Göteborg), basketteur plutôt doué dans ses jeunes années, grâce à sa taille vertigineuse, mais qu’une rébellion à fleur de peau engage à suivre les chemins de traverse. Comme Molko à cette période, il vit de petits boulots mal payés. Sûr qu’une des premières questions à retentir fut : « Mais qu’est-ce que tu fous là, ici à Londres ? » En fait, après avoir poursuivi ses études en Suède, Olsdal a suivi ses parents dans la capitale anglaise afin de rejoindre le Musicians Institute. Car par un nouvel heureux hasard, il est musicien, lui aussi. Sauf que lui c’est plus sérieux : multi-instrumentiste (guitariste, pianiste, bassiste et batteur), il possède une parfaite connaissance théorique en totale opposition à l’autodidactisme approximatif de Brian. « C’est le genre de type qui, en marchant dans la rue, peut te dire sur quelles notes sonnent les différents klaxons des voitures. » précise ce dernier. Ses influences à lui, ça va du classique au heavy metal, surtout le heavy metal dans lequel il se jette, majeur tendu vers ses parents, même si son groupe préféré reste Depeche Mode. Il aime bien Abba, aussi, mais ça c’est son côté suédois (il reconnaît pouvoir pleurer à l’écoute de The Winner Takes It All, personne sauf lui-même ne peut dire s’il est sérieux ou pas).
Entendons-nous bien : Olsdal et Molko ne sont pas potes, à la base. Au Luxembourg, ils s’ignoraient même superbement, un bon vieux problème d’origine sociale, de gens qui ne se mélangent pas. C’est donc du bout des lèvres, comme on lance en partant un « faudra qu’on se fasse une bouffe » qui sonne comme un adieu à un vieux camarade auquel on ne sait plus quoi dire, sans conviction, que le petit brun propose au grand blond de venir les voir, lui et Hewitt le soir-même, lors d’un show au « Round The Bell ». Surprise, Stefan est emballé, et dès lors il ne leur reste plus qu’à s’apprivoiser. Le coup de foudre artistique est mutuel, ces deux-là ne se quitteront plus.
Celui qui les lâche, en revanche, c’est Hewitt, qui se barre avec Breed pour rejoindre Nick Cave. Il leur faut donc un nouveau batteur, Olsdal fouille dans son carnet, et ça tombe bien il a ça en stock : c’est Robert Schultzberg, qu’il a fréquenté en Suède.

Début de traitement
Cette fois-ci, c’est fait : Placebo prend son appellation définitive et étrenne les chansons que Molko a composées au Covent Garden le 23 janvier 1995. Bon l’ombre de Steve plane encore sur la formation. D’ailleurs, il vient filer un coup de main de temps à autres, et il joue même sur les premières démos du groupe, mais lorsque celui-ci signe chez Caroline Records, c’est bien Schultzberg dont le nom figure sur le contrat. Placebo écume les clubs, assure les premières parties de Kula Shaker, Bush et autres groupes indie rock dont la vague commence juste à déferler. Et le public de découvrir sur scène ce petit chanteur énervé à la voix haut perchée qui transpire en faisant couler son maquillage sur sa jupe.
 Ah oui, j’avais presque oublié : Brian Molko porte le cheveu long et parfois des jupes. Brian Molko est androgyne. Brian Molko a une sexualité hors des clichés puritains qu’il affiche sans complexe. Et, il faut bien l’admettre, cette caractéristique participera d’une façon importante à la notoriété grandissante du groupe. Au départ, certains pensent même que le chanteur est une chanteuse. Celui-ci en joue, mais pour faire réagir, réfléchir. Il s’amuse de voir des mecs se méprendre sur son identité sexuelle, se rendre compte soudain qu’ils viennent de fantasmer sur un autre homme. Par erreur, mais fantasmer tout de même. Et plus la personne est homophobe, plus ça l’amuse. Fuck les tabous et les clivages, Placebo est adepte du coup de talon dans la fourmilière. Pourquoi se maquillent-ils ? Parce qu’ils sont plus sexy comme ça, point barre. Et surtout pas pour une question de vague revival goth dont ils n’ont à peu près que foutre. Non, ça n’est pas pour ressembler à Robert Smith, le rouge à lèvre, malgré tout le respect qui lui est dû, et les points communs qu’on peut trouver aux musiques respectives de Placebo et de The Cure. S’il fallait leur chercher une idole, ou tout du moins un exemple, il faudrait plutôt fouiller du côté de David Bowie. Bowie qui lui-même prend en quelque sorte le groupe sous son aile. Come Home, leur premier single, sort le 5 février 1996, et ça n’est que trois jours plus tard que la bande à Molko entame la première d’une série de cinq dates en première partie du Thin White Duke, en Italie, puis en France et enfin en Suisse. À ce stade, Placebo jouit déjà d’une belle notoriété, son premier album est annoncé et attendu, bien que son leader prévienne qu’il ne sera pas exactement à l’image de ce que le groupe donne à entendre sur scène. Celui-ci sort quelques mois plus tard, avec Brad Wood (qui a déjà bossé avec Tortoise) aux manettes.
Ah oui, j’avais presque oublié : Brian Molko porte le cheveu long et parfois des jupes. Brian Molko est androgyne. Brian Molko a une sexualité hors des clichés puritains qu’il affiche sans complexe. Et, il faut bien l’admettre, cette caractéristique participera d’une façon importante à la notoriété grandissante du groupe. Au départ, certains pensent même que le chanteur est une chanteuse. Celui-ci en joue, mais pour faire réagir, réfléchir. Il s’amuse de voir des mecs se méprendre sur son identité sexuelle, se rendre compte soudain qu’ils viennent de fantasmer sur un autre homme. Par erreur, mais fantasmer tout de même. Et plus la personne est homophobe, plus ça l’amuse. Fuck les tabous et les clivages, Placebo est adepte du coup de talon dans la fourmilière. Pourquoi se maquillent-ils ? Parce qu’ils sont plus sexy comme ça, point barre. Et surtout pas pour une question de vague revival goth dont ils n’ont à peu près que foutre. Non, ça n’est pas pour ressembler à Robert Smith, le rouge à lèvre, malgré tout le respect qui lui est dû, et les points communs qu’on peut trouver aux musiques respectives de Placebo et de The Cure. S’il fallait leur chercher une idole, ou tout du moins un exemple, il faudrait plutôt fouiller du côté de David Bowie. Bowie qui lui-même prend en quelque sorte le groupe sous son aile. Come Home, leur premier single, sort le 5 février 1996, et ça n’est que trois jours plus tard que la bande à Molko entame la première d’une série de cinq dates en première partie du Thin White Duke, en Italie, puis en France et enfin en Suisse. À ce stade, Placebo jouit déjà d’une belle notoriété, son premier album est annoncé et attendu, bien que son leader prévienne qu’il ne sera pas exactement à l’image de ce que le groupe donne à entendre sur scène. Celui-ci sort quelques mois plus tard, avec Brad Wood (qui a déjà bossé avec Tortoise) aux manettes.

L’accueil critique comme public est excellent. La presse s’échauffe et se lance dans la comparaison tous azimut. Elle y voit du The Cure, ce qui lui permet quelques jeux de mots Placebo/Cure faciles, elle y voit un potentiel à la U2, rien que ça. Il faut dire que ce premier essai est un coup de maître. Pas étonnant qu’il y soit vu un parfait antidote à la britpop. Et puis ils ne sont pas grands-bretons de toute manière. Les paroles sont toutes empreintes de noire mélancolie, de colère et de désespoir, reflet de l’état d’esprit dans lequel Molko les a couchées sur papier : alors au chômage, en pleine dépression, replié au plus profond de lui-même.
Brian déclara : « Il (l’album) a été écrit dans un taudis, dans la banlieue londonienne de Dartford. Je me sentais coincé dans cet endroit atroce, au chômage, sans issue. Sans le groupe, je ne me serais jamais levé le matin. Je devenais léthargique, sortir de mon appartement demandait un effort, c’était trop déprimant. »
"I know, the past will catch you up as you run faster (I Know)Since I was born I started to decay.Now nothing ever ever goes my way" (Teenage Angst)
Il chante ces vers d’une voie aigrelette, comme il ne le fera plus jamais par la suite, versant toujours davantage dans la confusion des genres. C’est le trépidant single Come Home qui annonce la couleur. La pochette également, ce gamin qui semble livrer son interprétation du tableau Le Cri, d’Edvard Munch. Sauf que son visage semble couler, se dissoudre, un visuel qui laisse entendre que quelque chose d’enfantin va se répandre, en larmes, ou dans le caniveau. Les guitares sont tranchantes comme des lames, parfois presque épileptiques, comme sur Bruise Pristine (Brian déclare avoir enregistré ce titre complètement nu, ce qui n’a sans doute rien à voir avec la musique, mais méritait d’être signalé), la batterie crépitante. Énergie punk il y a, puisque Brian y tient, mais pas seulement. Le groupe tient à ne pas s’enfermer dans un style trop étriqué et ouvre la porte à des expérimentations qu’il poursuivra toute sa carrière durant. Entendons-nous : lorsque l’on parle d’expérimentation, il n’est pas question de longs soli de guitare, rien de pompeux, rien d’intello. Mais une volonté de jouer avec les sonorités, de colorer la musique, avec des bruits de jouets, des samples, d’évoquer, l’enfance, les frustrations. Tout est déjà là, à l’état larvaire, sur ce premier disque. Ce qui est là, surtout, ce sont les bonnes chansons, l’imparable Bionic, le très représentatif Teenage Angst, ou encore Nancy Boy. Ce dernier titre et l’attaque de Schultzberg annonce en quelque sorte les gros tubes ultérieurs tels Pure Morning ou Taste In Man. I Know possède ce caractère déchirant / larmoyant cher à Placebo mais qui sonne ici plus spontané, moins dégrossi, plus frais en somme. C’est ce côté juvénile qui fera les beaux premiers jours, et la réputation du combo. Les ventes colossales ultérieures focaliseront l’attention sur les productions les plus récentes, et pourtant nombreux sont ceux qui considèrent qu’une grande part des chansons les plus réussies du groupe se trouve sur cet album.
Le succès est là, mais tout n’est pas rose au sein de Placebo. Le groupe est miné par une mésentente flagrante entre Brian Molko et Robert Schultzberg. Le batteur est agacé par les exhubérances de son leader, la rupture est consommée rapidement, et d’un commun accord.
 Chassez un batteur par la porte, un autre entre par la fenêtre : c’est ce bon vieux Steve Hewitt qui rentre au bercail. À peine le temps pour lui d’apprendre les morceaux qu’il faut partir défendre Placebo sur un maximum de scènes possibles. Le groupe écume les festivals, en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada, fait la première partie de Weezer, Iggy Pop, David Bowie bien entendu qui les convie même à son très select cinquantième anniversaire, ou encore U2.
Chassez un batteur par la porte, un autre entre par la fenêtre : c’est ce bon vieux Steve Hewitt qui rentre au bercail. À peine le temps pour lui d’apprendre les morceaux qu’il faut partir défendre Placebo sur un maximum de scènes possibles. Le groupe écume les festivals, en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada, fait la première partie de Weezer, Iggy Pop, David Bowie bien entendu qui les convie même à son très select cinquantième anniversaire, ou encore U2.
Premier chef-d’œuvre
Malgré son statut revendiqué de groupe « indé », Molko et sa bande voient loin. Ils quittent Caroline Records pour les gros de chez Virgin en 1997 afin d’y élaborer la suite des évènements. Et le moins que l’on puisse dire est que l’humeur n’est pas spécialement à la franche rigolade. Le groupe part s’isoler dans un air plus pur.
Brian Molko : « Quand je me suis mis à écrire les paroles, ma vie professionnelle n’avait jamais été aussi florissante. Par contre ma vie privée n’avait jamais été aussi catastrophique. Je me détestais pour en être arrivé là, pour avoir laissé mon cœur se briser en petits morceaux, pour avoir à ce point maltraité des gens chers. »
Le reste du groupe est au diapason, et le titre du nouvel opus tout trouvé (avant même que la musique ne soit composée) : Without You I’m Nothing, cri du cœur à l’attention des délaissés et de ceux qui les ont délaissés. Par leur faute. Déclaration d’amour entre membres, également, puisque leur vie ne s’est jamais autant résumée qu’à leur activité au sein de Placebo. Néanmoins, refrain connu, la détresse est souvent un formidable vivier créatif, ça n’est pas en ces instants qu’il est question de déroger à la règle, l’écriture coule toute seule, les titres s’enchaînent sans heurts majeurs, le groupe se rassure : la suite ne peut qu’être grandiose.

Le 3 août 1998 sort le single de la tant attendue séquelle à Placebo. Il s’appelle Pure Morning et constitue une claque magistrale qui enfoncera plus fort encore les quelques portes du succès qui demeuraient closes. C’est à peu près à ce moment-là, en effet, que les grands media commencent à s’intéresser au groupe. Virgin, c’est une puissance de diffusion supérieure, on entendait déjà un peu de Placebo sur certaines radios, mais cette fois-ci leur musique commence à tourner en boucle, la télévision aussi se met à inviter Molko et ses hommes. Et à diffuser le clip (réalisé par Nick Gordon). Ce clip, tous ceux qui l’ont vu en gardent un souvenir impérissable, qu’ils en aient goûté la musique ou non. Une foule terrifiée fixant le haut d’un immeuble au bord duquel se tient une personne (Brian Molko, plus féminin que jamais), prête à commettre l’irréparable. Pour bon nombre d’amateurs de rock (dont l’auteur de ces lignes), ces images sont le point de départ d’une passion éternelle, peu de groupes avaient su porter le mal-être au sommet du glamour. Bien entendu, le chanteur était « bizarre », sa voix de canard peut être irritante et peu mélodieuse de prime abord. Il y avait aussi son français parfait, ajoutant à la désorientation que provoquaient alors chacune de ses apparitions : Garçon ? Fille ? Anglais ? Français ? Rien n’est défini a priori, avec Placebo, chacun doit remettre en cause ses certitudes les plus établies. Parmi ces certitudes, il en demeure une qui frappe d’emblée et reste inébranlable, c’est la qualité de l’album Without You I’m Nothing. Il démarre sur les chapeaux de roues avec Pure Morning, le single évoqué plus haut, lancinant mais puissant, et dont, de manière surprenante, Molko reniera les paroles, plus tard : « [...]En revanche, une chanson comme Pure Morning, je trouve ça super au niveau musical, mais les textes... c’est de la merde. C’est pas possible d’écrire un truc comme ça ! Du coup, sur scène, je me concentre sur la guitare et j’essaie d’oublier les mots ». Il poursuit avec un morceau très dur dans la forme et dans le fond, Brick Shithouse, une sombre histoire de cocufiage plutôt drôle et réjouissante, la vraie rampe de lancement du disque. Il est suivi du très Cure You Don’t Care About Us. La nouveauté, c’est l’apparition de titres vraiment lents et minimalistes, preuve que Placebo tient parole et se met en danger en tentant la mise à nu, toujours dangereuse pour qui n’a rien dans le bide, ce qui n’est pas leur cas. Ask For Answers est de cette veine, et est une réussite. The Crawl un peu moins, il laisse un goût d’inachevé, peut-être voulu par le groupe, mais du coup il est soit trop sombre soit pas assez, comme le cul entre deux chaises. Dans le genre, My Sweet Prince est une merveille. Une chanson d’amour comme le groupe n’en fera quasiment plus jamais, pleine de mots simples mais à leur juste place, on découvre à quel point un Molko plus apaisé dans ses vocalises peut s’avérer un chanteur remarquable. Avec Without You I’m Nothing, Placebo entame sa collection de tubes imparables : Allergic, moment de folie lorsqu’il est interprété en live (comme la plupart de leurs titres, d’ailleurs), Every You Every Me, qui fera le bonheur d’un teenage movie (Crual Intentions) adapté des Liaisons Dangereuses, et surtout le morceau titre, « l’autre » chanson d’amour monstrueuse (avec My Sweet Prince, donc), qui sera tellement réclamée au groupe lors des tournées suivantes qu’il finira par la virer durant une longue période, jugeant ne plus pouvoir y apporter quoi que ce soit de neuf et de spontané. Without You I’m Nothing se clôt par Burgen Queen, allusion au passé luxembourgeois (le jeu de mot « Luxemburger queen », à rapprocher d’une enseigne de restauration rapide).
Brian Molko : « C’est une chanson très calme, très triste. Le personnage que je mets en scène cumule les pires caractéristiques qu’on puisse avoir au Luxembourg : il est gay, goth et accro à l’héroïne. Quand j’en parle, ça me fait plutôt sourire. Mais je pense que ça donne une idée assez juste de ce que peut être la vie au Luxembourg. [...]Ce personnage, ça pourrait être chacun de nous. Il suffit d’être né un peu malchanceux, au mauvais endroit. »
 Pour beaucoup, cet album reste le « big one », le meilleur du combo considéré comme à son sommet. Ça se discute. Autour de ce disque, il faut noter les deux appels du pied à notre douce France, qui s’est tout de suite prise de passion pour nos trois larrons. Nicholas Elliot, metteur en scène et acteur à ses heures (il a notamment joué dans Shadow Of The Vampire d’Elias Merhige), traduit Burger Queen en français pour Molko qui l’enregistre et le fait paraître spécialement pour nous. Gentil, non ? Et c’est pas fini : dans un autre style, mais il y a l’intrigante bossa-nova de Mars Landing Party, qui figure en b-side de Pure Morning, et son leitmotiv « embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul », que Molko définit comme une rencontre entre The Girl From Ipanema et Je T’Aime Moi Non Plus. Le titre bonus/caché aussi vaut le détour : il s’agit de la mise en musique d’un message laissé par un maniaque sur le répondeur de Brian. Inquiétant. De ces sessions est également issu la cover de 20th Century Boy des T-Rex, renforçant l’image glam du groupe aux yeux du public et qui servira au film Velvet Goldmine, où le trio fait une apparition. Enfin, plus notable est l’enregistrement d’une version de Without You I’m Nothing en duo avec Bowie. On peut considérer cette initiative comme l’expression publique définitive de leur affection réciproque : après ce sublime effort, il ne sera plus utile d’y revenir.
Pour beaucoup, cet album reste le « big one », le meilleur du combo considéré comme à son sommet. Ça se discute. Autour de ce disque, il faut noter les deux appels du pied à notre douce France, qui s’est tout de suite prise de passion pour nos trois larrons. Nicholas Elliot, metteur en scène et acteur à ses heures (il a notamment joué dans Shadow Of The Vampire d’Elias Merhige), traduit Burger Queen en français pour Molko qui l’enregistre et le fait paraître spécialement pour nous. Gentil, non ? Et c’est pas fini : dans un autre style, mais il y a l’intrigante bossa-nova de Mars Landing Party, qui figure en b-side de Pure Morning, et son leitmotiv « embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul », que Molko définit comme une rencontre entre The Girl From Ipanema et Je T’Aime Moi Non Plus. Le titre bonus/caché aussi vaut le détour : il s’agit de la mise en musique d’un message laissé par un maniaque sur le répondeur de Brian. Inquiétant. De ces sessions est également issu la cover de 20th Century Boy des T-Rex, renforçant l’image glam du groupe aux yeux du public et qui servira au film Velvet Goldmine, où le trio fait une apparition. Enfin, plus notable est l’enregistrement d’une version de Without You I’m Nothing en duo avec Bowie. On peut considérer cette initiative comme l’expression publique définitive de leur affection réciproque : après ce sublime effort, il ne sera plus utile d’y revenir.
Le toujours difficile troisième album
Le revers de médaille majeur lorsque l’on réalise un chef-d’oeuvre, c’est d’y donner suite sans y faire honte. Placebo a franchi haut la main le cap du « toujours difficile deuxième album », mais paradoxalement c’est à présent que tout va se jouer : l’essai est marqué, mais il faut le transformer. Pour cela, le groupe décide de prendre lui-même en main la production du disque à venir, aidé tout de même en cela par Paul Corkett. Son titre ? Black Market Music. Explication de texte par Brian Molko : « Black Market Music est une référence à quelque chose de sordide et de minable, quelque chose gardé sous le manteau, fondamentalement quelque chose d’illégal qu’on n’est pas censé posséder. C’est de là que vient l’idée, mais nous étions au Japon l’autre jour, nous traînions avec Taylor Hawkins des Foo Fighters et nous lui avons dit le nom de l’album et lui « ah oui, d’après le magasin de musique à L.A. ! » et alors il m’est revenu que c’était aussi le nom d’un endroit où nous avions quelques unes de nos guitares les plus chères en Amérique. Nous n’avions jamais fait le rapprochement jusqu’à ce que Taylor nous l’ait fait remarquer. Alors nous essayions de penser à une réponse vraiment philosophique, mais maintenant nous pouvons juste dire que le nom vient d’un magasin de musique. »
 L’affaire commence donc sur un malentendu, mais tant que la musique est bonne... Celle-ci est dévoilée via le single Taste In Men, le 17 juillet 2000. Le son, qui a enflé de façon considérable, permet à Hewitt de frapper comme une mule, et au groupe d’explorer plus avant les possibilités des samplers. C’est très bon, mais on sent confusément que quelque chose a changé, et il est difficile de déterminer alors si c’est pour le meilleur ou pour le pire. Et l’album qui sort le 9 octobre fait tout sauf lever le doute. En cause, la production. On flirte avec ce qui a fait tant de mal dans les 80’s, ces sonorités froides et sans âme. Ame il y a toujours, mais elle est moins perceptible, le tout manque de cohésion, et malgré la grande qualité des compositions, celles-ci sont gâchées par la relative laideur du son. Et puis, il y a quelques maladresses, telle Spite And Malice, en duo avec le rappeur Justin Warfield, exercice de style audacieux mais à demi satisfaisant seulement. Cette chanson est aussi un des « actes politiques » les plus manifestes du groupe, jusque là plutôt discret sur ce plan : « c’était une réaction à ce que nous voyons dans les news. Ce n’est pas un appel aux armes et à l’insurrection. Il y a 200 millions de flingues en circulation aux États-Unis, c’est une pensée effrayante », explique le chanteur. Concernant l’art et la politique : « Les gens qui disent que la politique et la musique ne peuvent se mélanger devraient juste rentrer chez eux regarder Dawson. Le simple fait de s’exprimer par l’art est politique. Tu montres une certaine vision du monde. » Ce qui sauve l’album (qualitativement, car au niveau des ventes, Placebo ne craint plus personne, et Black Market Music s’arrache en plus grandes quantités encore que ses prédécesseurs), ce sont les imparables Special K, Black Eyed et Slave To The Wage pour les orages électriques, et Peeping Tom et Blue American, pour les lenteurs émouvantes. Et puis, le groupe se rattrape dans le domaine où il est parmi les meilleurs : le live. C’est là que se révèle la force des compositions, et le groupe assène chacune d’elle avec une conviction mêlée de classe qui séduit même les plus réticents. On peut ne pas aimer Black Market Music, mais on ne peut pas ne pas aimer ce que Placebo en fait sur une scène. Un Special K peut renverser des foules entières, un Black Eyed faire hurler son refrain par plusieurs milliers de personnes comme un seul homme. Un public qui, d’ailleurs, commence à cette époque à changer. Si Placebo fait moins que jamais l’unanimité chez les critiques rock, il embrasse un succès populaire qui en fait progressivement l’idole des teenagers. Le rock à tendances romantiques est revenu à la mode, un combo tel Indochine (dont Nicolas Sirkis, le leader, devient le super pote à Brian) sorti du formol se refait une santé et trouve écho chez des adolescents qui redécouvrent les guitares et se reconnaissent dans cette sorte d’énergie juvénile qui transpire chez Placebo. Et la personnalité de Molko, qui envahit les media, clinquante, piquante, espiègle mais jamais conne, ajoutée à des attraits physiques évidents, en fait une star plus glamour que n’importe quel produit pré-fabriqué R&B ou hip-hop.
L’affaire commence donc sur un malentendu, mais tant que la musique est bonne... Celle-ci est dévoilée via le single Taste In Men, le 17 juillet 2000. Le son, qui a enflé de façon considérable, permet à Hewitt de frapper comme une mule, et au groupe d’explorer plus avant les possibilités des samplers. C’est très bon, mais on sent confusément que quelque chose a changé, et il est difficile de déterminer alors si c’est pour le meilleur ou pour le pire. Et l’album qui sort le 9 octobre fait tout sauf lever le doute. En cause, la production. On flirte avec ce qui a fait tant de mal dans les 80’s, ces sonorités froides et sans âme. Ame il y a toujours, mais elle est moins perceptible, le tout manque de cohésion, et malgré la grande qualité des compositions, celles-ci sont gâchées par la relative laideur du son. Et puis, il y a quelques maladresses, telle Spite And Malice, en duo avec le rappeur Justin Warfield, exercice de style audacieux mais à demi satisfaisant seulement. Cette chanson est aussi un des « actes politiques » les plus manifestes du groupe, jusque là plutôt discret sur ce plan : « c’était une réaction à ce que nous voyons dans les news. Ce n’est pas un appel aux armes et à l’insurrection. Il y a 200 millions de flingues en circulation aux États-Unis, c’est une pensée effrayante », explique le chanteur. Concernant l’art et la politique : « Les gens qui disent que la politique et la musique ne peuvent se mélanger devraient juste rentrer chez eux regarder Dawson. Le simple fait de s’exprimer par l’art est politique. Tu montres une certaine vision du monde. » Ce qui sauve l’album (qualitativement, car au niveau des ventes, Placebo ne craint plus personne, et Black Market Music s’arrache en plus grandes quantités encore que ses prédécesseurs), ce sont les imparables Special K, Black Eyed et Slave To The Wage pour les orages électriques, et Peeping Tom et Blue American, pour les lenteurs émouvantes. Et puis, le groupe se rattrape dans le domaine où il est parmi les meilleurs : le live. C’est là que se révèle la force des compositions, et le groupe assène chacune d’elle avec une conviction mêlée de classe qui séduit même les plus réticents. On peut ne pas aimer Black Market Music, mais on ne peut pas ne pas aimer ce que Placebo en fait sur une scène. Un Special K peut renverser des foules entières, un Black Eyed faire hurler son refrain par plusieurs milliers de personnes comme un seul homme. Un public qui, d’ailleurs, commence à cette époque à changer. Si Placebo fait moins que jamais l’unanimité chez les critiques rock, il embrasse un succès populaire qui en fait progressivement l’idole des teenagers. Le rock à tendances romantiques est revenu à la mode, un combo tel Indochine (dont Nicolas Sirkis, le leader, devient le super pote à Brian) sorti du formol se refait une santé et trouve écho chez des adolescents qui redécouvrent les guitares et se reconnaissent dans cette sorte d’énergie juvénile qui transpire chez Placebo. Et la personnalité de Molko, qui envahit les media, clinquante, piquante, espiègle mais jamais conne, ajoutée à des attraits physiques évidents, en fait une star plus glamour que n’importe quel produit pré-fabriqué R&B ou hip-hop.
Retrouver des couleurs
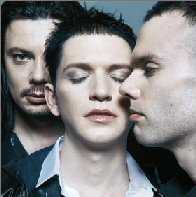 Après une tournée éreintante, Placebo entre en studio pour préparer la suite de Black Market Music. Pas question pour eux de retomber dans les mêmes errements, Jim Abbiss est appelé pour aider le groupe à accoucher de Sleeping With Ghosts (titre emprunté à Don McCullin, un photographe de guerre). Abbiss a bossé avec de nombreux artistes électro, tels U.N.K.L.E. ou DJ Shadow, on pressent donc une implication plus grande encore d’artifices électroniques. Et on ne se trompe pas. C’est The Bitter End qui est envoyé en éclaireur aux radios, en mars 2003, et la machine s’emballe immédiatement. On ne peut pas parler de diffusion au sujet de ce single : il faut employer le terme matraquage. The Bitter End tourne en boucle sur les ondes, les ados adorent, et les fans de la première heure, eux, grincent des dents. L’album, qui paraît en septembre, est excellent. Oublié les approximations de Black Market Music : le groupe a retenu les leçons qui devaient l’être, et, avec Jim Abbiss, tisse un écrin résolument moderne et sophistiqué mais qui n’oublie jamais d’être vecteur à pleine puissance de toute la soul dont le cœur de Placebo regorge. Sleeping With Ghosts débute de façon surprenante par un instrumental complètement rock qui constituera une excellente intro pour les tournées à venir. English Summer Rain est une nouvelle chanson répétitive, dans la lignée de Pure Morning ou Taste In Men, mais presque techno et tout aussi bonne si ce n’est davantage que ces dernières. Placebo semble régénéré : il aligne les pépites. Le single évoqué plus haut est irrésistible dans le genre power-pop, et il possède de sublimes petits frères tels This Picture, très Pixies dans l’exécution, ou Plasticine où le groupe lorgne légèrement du côté du metal, prouvant s’il était besoin qu’il reste rock quoi qu’il arrive. Toujours volontaire pour élargir son horizon, Placebo a su composer un Something Rotten qui pourrait avoir été écrit par Massive Attack, mais sans que le groupe y perde sa patte. Sleeping With Ghosts, le morceau-titre est un bijou mélancolique. L’album contient aussi une des chansons les plus personnelles de Brian Molko, celle où il reconnaît avoir donné le plus de lui-même. Il s’agit de Protect Me From What I Want, composée lors des sessions du disque précédent : « Je l’ai composée pendant Black Market Music, comme I’ll Be Yours. Ce sont deux chansons qui se vomissent, qui sont sorties de moi sans que je m’en rende compte. À l’époque, j’étais fragile. J’étais empêtré dans un divorce douloureux et j’avais besoin de l’exprimer ». Et, comme pour Burger Queen quelques années auparavant, Placebo enregistre une version française de cette valse intimiste. Cette fois-ci, c’est une invitée de choix qui va effectuer la traduction : l’écrivain et sulfureuse Virginie Despentes. Cette version, quoi qu’originale, n’est pas vraiment une réussite, mais elle sera pourtant bien accueillie (aussi bons que soient ses bouquins, Despentes n’est pas songwriter), parce qu’une rencontre entre de tels individus avait quelque chose d’attirant a priori.
Après une tournée éreintante, Placebo entre en studio pour préparer la suite de Black Market Music. Pas question pour eux de retomber dans les mêmes errements, Jim Abbiss est appelé pour aider le groupe à accoucher de Sleeping With Ghosts (titre emprunté à Don McCullin, un photographe de guerre). Abbiss a bossé avec de nombreux artistes électro, tels U.N.K.L.E. ou DJ Shadow, on pressent donc une implication plus grande encore d’artifices électroniques. Et on ne se trompe pas. C’est The Bitter End qui est envoyé en éclaireur aux radios, en mars 2003, et la machine s’emballe immédiatement. On ne peut pas parler de diffusion au sujet de ce single : il faut employer le terme matraquage. The Bitter End tourne en boucle sur les ondes, les ados adorent, et les fans de la première heure, eux, grincent des dents. L’album, qui paraît en septembre, est excellent. Oublié les approximations de Black Market Music : le groupe a retenu les leçons qui devaient l’être, et, avec Jim Abbiss, tisse un écrin résolument moderne et sophistiqué mais qui n’oublie jamais d’être vecteur à pleine puissance de toute la soul dont le cœur de Placebo regorge. Sleeping With Ghosts débute de façon surprenante par un instrumental complètement rock qui constituera une excellente intro pour les tournées à venir. English Summer Rain est une nouvelle chanson répétitive, dans la lignée de Pure Morning ou Taste In Men, mais presque techno et tout aussi bonne si ce n’est davantage que ces dernières. Placebo semble régénéré : il aligne les pépites. Le single évoqué plus haut est irrésistible dans le genre power-pop, et il possède de sublimes petits frères tels This Picture, très Pixies dans l’exécution, ou Plasticine où le groupe lorgne légèrement du côté du metal, prouvant s’il était besoin qu’il reste rock quoi qu’il arrive. Toujours volontaire pour élargir son horizon, Placebo a su composer un Something Rotten qui pourrait avoir été écrit par Massive Attack, mais sans que le groupe y perde sa patte. Sleeping With Ghosts, le morceau-titre est un bijou mélancolique. L’album contient aussi une des chansons les plus personnelles de Brian Molko, celle où il reconnaît avoir donné le plus de lui-même. Il s’agit de Protect Me From What I Want, composée lors des sessions du disque précédent : « Je l’ai composée pendant Black Market Music, comme I’ll Be Yours. Ce sont deux chansons qui se vomissent, qui sont sorties de moi sans que je m’en rende compte. À l’époque, j’étais fragile. J’étais empêtré dans un divorce douloureux et j’avais besoin de l’exprimer ». Et, comme pour Burger Queen quelques années auparavant, Placebo enregistre une version française de cette valse intimiste. Cette fois-ci, c’est une invitée de choix qui va effectuer la traduction : l’écrivain et sulfureuse Virginie Despentes. Cette version, quoi qu’originale, n’est pas vraiment une réussite, mais elle sera pourtant bien accueillie (aussi bons que soient ses bouquins, Despentes n’est pas songwriter), parce qu’une rencontre entre de tels individus avait quelque chose d’attirant a priori.
Sleeping With Ghosts disposera d’une seconde édition, agrémentée d’un étrange disque de reprises, que le groupe a parfois utilisées en face B durant sa carrière. Il y a ce qu’on entendait, ou du moins ce qui pouvait l’être, comme La Ballade De Melody Nelson de Gainsbourg (qui cette fois suit le chemin inverse de ce à quoi le groupe nous a habitué, puisque chantée en anglais), ou I Feel You de Depeche Mode, déjà parue sur l’édition américaine de Black Market Music. Il y a 20th Century Boy de T-Rex, dont on a déjà parlé. Et puis il y a les surprises : Johnny And Mary de Robert Palmer, une chanson que Stefan Olsdal adore et que le groupe a joué « pour qu’il nous lâche avec ça ». Il y a Running Up That Hill de Kate Bush. Pire encore : il y a Daddy Cool de Boney M. Toutes ces reprises sont d’une qualité inégale mais jamais médiocres. De toute façon, une seule fera date tant elle surpasse les autres : le Where Is My Mind des Pixies est un hommage tardif à l’une des plus grandes sources d’inspiration du groupe. Les Pixies, comme Placebo, jouissent d’une affection toute particulière de la part des français, d’où ce sentiment que cette reprise coulait simplement de source. Frank Black sera d’ailleurs invité par le groupe à interpréter à deux voix ce titre légendaire. La tournée de promotion de Sleeping With Ghost sera immortalisée sur le DVD Soulmates Never Dies, déjà chroniqué dans nos colonnes, où le groupe se montre sous son meilleur jour, bien qu’il reconnaisse avoir eu des difficultés à oublier les caméras durant la performance. Excellente et lucrative tournée, par ailleurs. Mais épuisante.
Après une tournée éreintante, Placebo entre en studio pour préparer la suite de Black Market Music. Pas question pour eux de retomber dans les mêmes errements, Jim Abbiss est appelé pour aider le groupe à accoucher de Sleeping With Ghosts (titre emprunté à Don McCullin, un photographe de guerre). Abbiss a bossé avec de nombreux artistes électro, tels U.N.K.L.E. ou DJ Shadow, on pressent donc une implication plus grande encore d’artifices électroniques. Et on ne se trompe pas. C’est The Bitter End qui est envoyé en éclaireur aux radios, en mars 2003, et la machine s’emballe immédiatement. On ne peut pas parler de diffusion au sujet de ce single : il faut employer le terme matraquage. The Bitter End tourne en boucle sur les ondes, les ados adorent, et les fans de la première heure, eux, grincent des dents. L’album, qui paraît en septembre, est excellent. Oublié les approximations de Black Market Music : le groupe a retenu les leçons qui devaient l’être, et, avec Jim Abbiss, tisse un écrin résolument moderne et sophistiqué mais qui n’oublie jamais d’être vecteur à pleine puissance de toute la soul dont le cœur de Placebo regorge. Sleeping With Ghosts débute de façon surprenante par un instrumental complètement rock qui constituera une excellente intro pour les tournées à venir. English Summer Rain est une nouvelle chanson répétitive, dans la lignée de Pure Morning ou Taste In Men, mais presque techno et tout aussi bonne si ce n’est davantage que ces dernières. Placebo semble régénéré : il aligne les pépites. Le single évoqué plus haut est irrésistible dans le genre power-pop, et il possède de sublimes petits frères tels This Picture, très Pixies dans l’exécution, ou Plasticine où le groupe lorgne légèrement du côté du metal, prouvant s’il était besoin qu’il reste rock quoi qu’il arrive. Toujours volontaire pour élargir son horizon, Placebo a su composer un Something Rotten qui pourrait avoir été écrit par Massive Attack, mais sans que le groupe y perde sa patte. Sleeping With Ghosts, le morceau-titre est un bijou mélancolique. L’album contient aussi une des chansons les plus personnelles de Brian Molko, celle où il reconnaît avoir donné le plus de lui-même. Il s’agit de Protect Me From What I Want, composée lors des sessions du disque précédent : « Je l’ai composée pendant Black Market Music, comme I’ll Be Yours. Ce sont deux chansons qui se vomissent, qui sont sorties de moi sans que je m’en rende compte. A l’époque, j’étais fragile. J’étais empêtré dans un divorce douloureux et j’avais besoin de l’exprimer. » Et, comme pour Burger Queen quelques années auparavant, Placebo enregistre une version française de cette valse intimiste. Cette fois-ci, c’est une invitée de choix qui va effectuer la traduction : l’écrivain et sulfureuse Virginie Despentes. Cette version, quoi qu’originale, n’est pas vraiment une réussite, mais elle sera pourtant bien accueillie (aussi bons que soient ses bouquins, Despentes n’est pas songwriter), parce qu’une rencontre entre de tels individus avait quelque chose d’attirant a priori.
Sleeping With Ghosts disposera d’une seconde édition, agrémentée d’un étrange disque de reprises, que le groupe a parfois utilisées en face B durant sa carrière. Il y a ce qu’on entendait, ou du moins ce qui pouvait l’être, comme La Ballade De Melody Nelson de Gainsbourg (qui cette fois suit le chemin inverse de ce à quoi le groupe nous a habitué, puisque chantée en anglais), ou I Feel You de Depeche Mode, déjà parue sur l’édition américaine de Black Market Music. Il y a 20th Century Boy de T-Rex, dont on a déjà parlé. Et puis il y a les surprises : Johnny And Mary de Robert Palmer, une chanson que Stefan Olsdal adore et que le groupe a joué « pour qu’il nous lâche avec ça ». Il y a Running Up That Hill de Kate Bush. Pire encore : il y a Daddy Cool de Boney M. Toutes ces reprises sont d’une qualité inégale mais jamais médiocres. De toute façon, une seule fera date tant elle surpasse les autres : le Where Is My Mind des Pixies est un hommage tardif à l’une des plus grandes sources d’inspiration du groupe. Les Pixies, comme Placebo, jouissent d’une affection toute particulière de la part des français, d’où ce sentiment que cette reprise coulait simplement de source. Frank Black sera d’ailleurs invité par le groupe à interpréter à deux voix ce titre légendaire. La tournée de promotion de Sleeping With Ghost sera immortalisée sur le DVD Soulmates Never Dies, déjà chroniqué dans nos colonnes, où le groupe se montre sous son meilleur jour, bien qu’il reconnaisse avoir eu des difficultés à oublier les caméras durant la performance. Excellente et lucrative tournée, par ailleurs. Mais épuisante.

Oui, ça y est, Placebo est rincé, vidé de toute énergie. Son succès ininterrompu depuis 1996 ainsi que son exposition médiatique toujours grandissante laisse des traces et des blessures qu’il faut prendre le temps de panser. Parallèlement, le groupe s’est efforcé d’aller chercher son public aux États-Unis, là où il est moins connu. Une sorte de retour aux sources puisque Placebo joue parfois devant un parterre de quelques centaines de personnes à peine, se rapprochant de ses racines punk-rock. Rafraîchissant mais pas de tout repos.
Pour faire patienter le public, le groupe fait paraître Once More With Feeling, qui regroupe tous les singles de Placebo depuis ses débuts, plus deux inédits : I Do et Twenty Years. La version DVD, elle, contient les clips de Placebo. Intéressant témoignage, même s’il s’agit d’un domaine où le compo se démarque assez peu de la masse. Le successeur de Sleeping With Ghosts, lui, est déjà écrit, mais Placebo préfère temporiser : « J’ai besoin de soleil et de plages. C’est pour ça que je vis à Londres » plaisante Brian. « Mais là, sérieusement, je pars vivre en Inde quelques mois. Je pense que ça n’aura aucune incidence sur l’album, parce qu’on l’a déjà écrit. En fait, on pourrait entrer en studio demain mais on ne veut pas. Il est temps de vivre un petit peu. »
Le groupe est fatigué, et ça tombe bien car il commence à fatiguer, notamment ses fans de la première heure, qui ont grandi avec lui. Irrités de voir « leur » groupe accaparé par les kids, irrités de l’entendre toutes les dix minutes sur des radios nases, irrités de l’hystérie autour du trio. Des fans inquiets, aussi. Le coup du CD et du DVD rétrospective, ça marque généralement la fin de quelque chose, et parfois même la fin d’un groupe tout simplement. Ou bien le signe qu’il n’a plus rien à dire, et qu’il veut tout de même continuer à capitaliser sa notoriété. Mais il n’en est rien, heureusement. Et puis si on y réfléchit, comment leur reprocher leur succès ? Leurs chansons ont toujours su se mettre à la portée de l’auditeur, sans effort, juste parce qu’elle sont naturellement bonnes, et sonnent comme des évidences. Et puis le rock, c’est quand même un truc de gamin, non ? C’est une colère adolescente qui glisse dans une guitare et explose en décibels. Non, Placebo n’a pas volé son succès. Et il ne se défroquera pas qualitativement.
D’ailleurs, il revient avec deux singles extraits de son nouveau bébé, intitulé Meds : Song To Say Goodbye, pour le monde entier, et Because I Want You, pour le « toujours difficile public britannique ».
Je l’ai dit plus haut : la suite ne peut être que somptueuse. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.
Contributions annexes
En marge de Placebo, chacun cultive sa différence, et enrichit son expérience dans des domaines divers. Ainsi, Brian Molko a-t-il joué les mannequins pour Agnes B., qui a habillé par ailleurs les autres membres de groupe. Il ne délaisse pas pour autant la musique, et a apporté sa contribution et sa voix nasillarde à plusieurs projets. Parmi eux AC Acoustic et le titre Crush, ou Trash Palace sur The Metric System. Les mêmes Trash Palace & Molko rejoints par Asia Argento, l’icône horrifique, sur une cover de Je T’Aime Moi Non Plus.Toujours du côté du grand Serge, il reprend en duo avec Françoise Hardy Requiem For A Jerk. Il file un coup de main à Alpinestar, également, sur le single Carbon Kid, et à Jane Birkin sur Smile. Sur le concept album de Kristeen Young, basé sur les 10 Commandements, Molko se charge de No Other God. Il participe bien entendu au nouvel album de ses potes d’Indochine, où il chante Pink Water 3.
Occasionnellement, il joue aussi les DJ lors de soirées parisiennes.
Stefan Olsdal aussi joue régulièrement les DJ, à Madrid, lors de quelques nuits, en 2005. Il a joué avec les Eagles Of The Death Metal, autre projet du prolifique Josh Homme. Ce groupe les a d’ailleurs accompagnés lors de leur tournée américaine la plus récente. Il a également fondé un combo electro nommé Material, aux côtés de David Amen. Le même groupe sera rejoint par Javier Solo sous le nom de Hotel Persona.
Steve Hewitt a semblé le moins actif en dehors de Placebo, puisqu’il s’est contenté de rejoindre son ancien groupe, Breed, lors d’un show en 2004.
Discographie :
Singles :
Come Home (5 février 1996)36 Degrees (1996)Teenage Angst (1996)Nancy Boy (version 1) (1997)Nancy Boy (version 2) (1997)Bruise Prinstine (version 1) (1997)Bruise Prinstine (version 2) (1997)Pure Morning (version 1) (3 août 1998)Pure Morning (version 2) (1998)You Don’t Care About Us (version 1) (1998)You Don’t Care About Us (version 2) (1998)Every You Every Me (version 1) (1999)Every You Every Me (version 2) (1999)Without You I’m Nothing (Feat. David Bowie) (1999)Burger Queen (en français) (1999)Taste In Men (version 1) (17 juillet 2000)Taste In Men (version 2) (2000)Slave To The Wage (version 1) (2000)Slave To The Wage (version 2) (2000)Special K (2001)Black Eyed (2001)The Bitter End (version 1) (mars 2003)The Bitter End (version 2) (2003)This Picture (2003)This Picture (single DVD) (2003)Special Needs (2003)Special Needs (single DVD) (2003)English Summer Rain (2003)English Summer Rain (enhanced CD)(2003)Protège-Moi (en français)(2004)Twenty Years (2004)Twenty Years (enhanced CD) (2004)Because I Want You (exclusivité pour la Grande-Bretagne) (2006)Because I Want You (enhanced CD) (2006)Song To Say Goodbye (sortie mondiale sauf Grande-Bretagne) (2006)Song To Say Goodbye (version maxi) (2006)Albums :Placebo (6 juin 1996)Without You I’m Nothing (1998)Black Market Music (2000)Sleeping With Ghosts (2003)Meds (2006)DVD :Soulmates Never Die - Live In Paris (2004)Once More With Feeling (singles 1996-2004) (2004)
[1]
[1] Sources utilisées pour la rédaction de cet article :
- sur la toile :
- Revue spécialisée : Les Inrockuptibles : Les Intégrales Rock #01



















Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
