Dernière publication :
mercredi 15 avril 2015
Rechercher
par mot-clé
par index

PJ Harvey, My Sweet Enemy
par Yuri-G le 8 mars 2011




Dès qu’on a connu ses chansons en formes de torpilles, prêtes à arracher violence et émotion, PJ Harvey est devenue indispensable. Son parcours est libre. Elle n’aura cessé de muer, tout au long d’une riche carrière, pour mieux exprimer sa personnalité discrète mais bouillonnante. Ses chansons belles et âpres ne se fiant jamais qu’à son sens du renouvellement, Polly Jean a érigé une sensibilité cohérente, des débuts furieux de Dry au folk hanté de White Chalk.
Choose Life
Polly Jean Harvey est née le 9 octobre 1969 dans le comté de Dorset, au sud-ouest de l’Angleterre. Le Dorset : on sait à quel point les lieux de l’enfance bâtissent et imprègnent l’identité de chacun. Pour la petite Polly, plus que jamais. Dans son monde, les villes sont oubliées. Le paysage est vaste, les landes imposantes, vent, pierre, bordé par la mer. Des légendes rôdent aussi, le spectre du roi Arthur ; le passé païen de la région, incantations et superstitions, n’y sont pas vraiment bannis.

- Polly, dans la campagne natale de Corscombe en 1992
En tout cas, pour Polly et son grand frère Saul, le Dorset et plus particulièrement le petit village de Corscombe, présentent un terrain de jeu idéal. La nature est grande, le ciel d’un bleu laiteux paraît vous fondre dessus à chaque instant, le soleil glacé, le vent agité, tout renvoie à un sentiment immense de plénitude. La ferme natale, achetée par Ray et Eva Harvey au début des années soixante, abrite joyeusement leurs scénarios de guerre ; Polly, engoncée dans un vieil uniforme râpeux, est le pauvre soldat britannique, qui se fait capturer par l’armée allemande (Saul et ses amis). Il faut dire qu’elle ne se fait pas prier pour participer à ces jeux de garçons. Elle aurait même plutôt tendance à rester collée à Saul et à l’imiter en tout. En fait, Polly est un vrai garçon manqué : les cheveux ras, elle préfère qu’on l’appelle Paul, et ses poupées trainent par terre sans qu’elle y touche. Seulement, elle réalise très vite qu’elle ne pourra jamais être un garçon, malgré tous ses efforts à mimer gestes, manières et codes virils. Alors, quand le grand frère se lasse de son invasion quotidienne, elle part s’isoler, se recueillir dans le monde fantasque des contes d’Andersen et des frères Grimm. Grande lectrice, elle découvrira ensuite William Burroughs, devenu depuis son auteur favori, et passera de longues nuits plongée dans la Bible : « Je pensais y trouver toutes les réponses, tout comprendre. Personne ne m’a donné le moindre rudiment de religion, il a fallu tout apprendre seule. Tant de choses ont été dites et faites au nom de ce livre, je devais savoir ce qu’il contenait. »
Mais il y a mieux, pour combler ses rêves déchus de masculinité : la collection de disques parentale. Elle pioche, John Lee Hooker, les Stones, Robert Johnson, Jimi Hendrix. Surtout, Bob Dylan et Captain Beefheart, ils ont vraiment quelque chose. Elle les écoute avec passion, bientôt elle connait par cœur tous les disques qu’elle a pu trouver. D’ailleurs, ses parents eux-mêmes sont loin de prendre la musique à la légère. Avides de rock’n’roll et de blues, ils invitent régulièrement des amis musiciens à la ferme de Corscombe, afin d’organiser des concerts dans les villages avoisinants. Ils vont jusqu’à construire une annexe, spécialement pour ces invités, toujours nombreux et heureux de profiter de la nature, enclins à jouer librement de leurs instruments partout et à tout moment. Grâce à eux, Polly apprend des rudiments de saxophone, son premier instrument.
Ce qui la pousse à intégrer l’orchestre de jazz du collège de Beaminster, qu’elle vient de rejoindre. Sa passion est d’autant plus exclusive et dévorante, qu’elle éprouve de grandes difficultés à se faire accepter par ses camarades. De nature indépendante, elle est timide, peut-être un peu sauvage, et son allure de garçon manqué, qu’elle n’a jamais vraiment quittée, lui vaut évidemment de nombreuses railleries : « Un jour, je me suis fait attraper par le principal parce que je ne portais pas de cravate. Je lui ai fait remarquer que j’étais une fille, il s’est excusé. Mais le mal était fait. Une autre fois, je me suis fait virer des toilettes des filles. Alors, je me suis dit qu’il fallait vraiment que je fasse quelque chose. »
Pour se sentir en phase avec ses pairs adolescents, connectée à un mouvement, elle découvre les groupes de l’époque, Tears For Fears, Duran Duran, Spandau Ballet et - les seuls qu’elle écoute encore aujourd’hui - Soft Cell (Tainted Love est une de ses chansons préférées), U2. Plus tard, viendront aussi les Pixies, Television, Nick Cave (From Her To Eternity la bouleverse), The Fall, Tom Waits, Slint. Mais le blues qu’elle a connu enfant, rien n’est aussi fort ; ce Captain Beefheart qui la hante. Polly, 18 ans, se met à la guitare acoustique, genèse de ses premiers émois. Elle apprend à en jouer seule, sur les chansons de Bob Dylan. Comme une urgence, décide de se produire dans quelques pubs alentour, au sein du trio qu’elle vient de former, The Polekats (avec un bassiste et un flûtiste).
Elle obtient son bac à la même époque et maintenant, se trouve obligée de regarder par delà l’horizon, explorer le lointain. Toute petite, elle prodiguait avec attention des soins aux animaux qui peuplaient la ferme, et les chevaux surtout la ravissaient. Devenir vétérinaire, c’était une direction ancrée en elle depuis si longtemps. Mais aujourd’hui la musique gagnait du terrain, lui offrait une liberté insoupçonnée, à elle qui jusqu’alors se sentait inadaptée aux flux incessants de la réalité, une délivrance, pour celle qui, piégée dans un corps et un visage qu’elle juge disgracieux, ne pouvait se résoudre à l’accepter. Il faut choisir, trancher, aujourd’hui. Elle préfère se donner une année, pour parcourir les possibilités, approfondir ses talents de guitariste et de compositrice naissants.
Et très vite, la voie lui est indiqué. Une rencontre cruciale, un soir de juillet 1987. C’est Jeremy Hogg, membre fraîchement recruté du groupe Automatic Dlamini, dont la figure tutélaire est un certain John Parish. Parish en est le guitariste et a décidé de vouer sa vie à la musique après avoir vu David Bowie en concert, à l’occasion de la tournée "Aladdin Sane". Il y a aussi le batteur, Rob Ellis. Deux personnages qui vont ouvrir un passage définitif dans la vie de Polly. Ce soir-là, elle se trouve donc à cette fête et engage la conversation avec Hogg ; elle doit être intimidée, Automatic Dlamini jouit tout de même d’une réputation assurée. Ils ont déjà sorti des singles, tourné dans le pays et même en France. Mais Polly fait face. Elle discute et finalement, demande si le groupe peut venir jouer à sa fête d’anniversaire, en octobre. Malheureusement non, le jour même Rob Ellis est malade. Mais les autres membres viennent de bon cœur et font sa connaissance ; ils se lient d’amitié. Pour elle, c’est une chance qui se déclare. Elle leur envoie quantité de démos, se trouve à tous leurs concerts. Et lorsque John Parish est à la recherche d’une choriste, elle est là, évidemment. Elle intègre le groupe, après s’être pliée à l’audition de rigueur.

- Automatic Dlamini
- De gauche à droite : Ichiro Tatsuhara, Ben Groenevelt, Polly Jean Harvey, John Parish et Jeremy Hogg
Au sein d’Automatic Dlamini, Polly fait ses vrais premiers pas sur scène, ses premières expériences studio, sa première tournée (à l’étranger qui plus est). Tout devrait être si euphorisant pour elle, plus d’un se laisserait aller à des balbutiements de triomphe. Pourtant, un sentiment d’incertitude la ronge. Rien n’est stable, rien n’est confirmé ; trop peu sûre d’elle, elle s’inscrit à l’université de Londres, section art graphique. Ainsi, elle gagne la capitale. Que peut-elle ressentir, lorsqu’elle s’immisce pour la première fois dans cette vague grouillante de visages fermés, lorsqu’elle longe les structures perçantes de métal qui dévorent l’espace ? Au cours de ses études, elle se tourne vers la sculpture, s’en éprend, doit de nouveau choisir. Ça ou la musique. Phase impitoyable que Polly traverse, assez troublée, travaillée par les hésitations et l’angoisse. Elle ne cesse d’osciller entre ces deux passions, et l’imminence d’une décision la paralyse. « J’ai toujours été une fille angoissée, je n’ai jamais été satisfaite de mon travail. Mais c’était la première fois que je ressentais vraiment les choses et j’en suis tombée physiquement malade. »
Novembre 89, Automatic Dlamini rentre en studio à Oxford pour enregistrer leur second album Here Catch, Shouted His Father. Bien sûr, Polly est présente à ces sessions ; une de ses chansons, Heaven, a été retenue dans le tracklisting. C’est sa toute première composition enregistrée professionnellement. L’expérience doit être stimulante.. clairement déterminante, car peu après, c’en est fait, elle décide de se lancer pour de bon, former son propre groupe. Le doute s’éteint pour un temps, ne pouvant tenir tête au séisme passionnel de la musique. En janvier 91, Polly s’entoure du batteur Rob Ellis (qui avait quitté Automatic Dlamini en 1988) et du bassiste Ian Olliver. Mark Vernon, un ami proche de Rob - il tenait le clavier dans le premier groupe de celui-ci à l’université - devient le manager du trio. Sans détour, leur union porte le nom de PJ Harvey.
Blues Is Sex Blues Is Raw
Le groupe commence à répéter ensemble ; Ian Olliver ne tarde pas à être remplacé par Steven Vaughan à la basse. Ils se produisent alors dans des salles étroites, voire même des bowlings (où l’accueil est si désastreux, qu’il arrive que le propriétaire les supplie d’arrêter de jouer). Mais pas question de se laisser abattre par de telles déconvenues. À force, ils s’attirent les faveurs d’un public croissant et Polly profite de quelques contacts pour envoyer trois démos - Dress, Happy And Bleeding et Sheela-Na-Gig - au label indépendant Too Pure, basé à Londres. C’est son co-fondateur en personne, Paul Cox, le premier à écouter cette petite cassette accompagnée de clichés « abstraits et flous », et il en ressort secoué : « C’était l’époque de la pop soignée et des guitares léchées. La scène rock avait été envahie par des shoegazers maniérés, souvent précieux autant que prétentieux. La musique de PJ Harvey, je l’ai prise comme un direct à l’estomac. C’était du rock basique, mis à nu par des guitares crues. »

- Le trio PJ Harvey
- Polly Jean Harvey, Rob Ellis et Steven Vaughan
Il contacte le trio et leur propose d’occuper la première partie de Moonshake, au Moonlight Club. Il n’y a pas d’hésitation, et bientôt ce concert est suivi par celui des Becketts, au Sausage Machine Club, où PJ Harvey obtient son premier écho critique, par Laura Davies de Time Out. Des éloges, des ondes de choc, mais tout n’était pas si évident, selon Cox : « Les concerts étaient biens mais sans plus. La timidité maladive de Polly l’empêchait de s’exprimer pleinement. Elle manquait cruellement de confiance en elle. Mais peut-être qu’au fond, ça a joué en sa faveur. Le public était surpris par la force dégagée par ce petit bout de femme. Par ses contradictions, elle exerçait une sorte de fascination sur les gens. »
Too Pure profite de cet essor déjà bien installé pour sortir, en octobre 1991, le premier single de PJ Harvey : Dress, composition tonitruante qui expose les déboires d’une jeune fille aux prises avec sa robe de soirée. D’entrée, rien ne pouvait plus suggérer les contradictions, pas totalement résorbées, de l’enfance de Polly. À 22 ans, elle refuse encore de vraiment se prêter au jeu : sans maquillage, ses cheveux résolument tirés en arrière, noués sur la nuque, elle adopte un profil rude et forcément viril, dissimulée derrière le noir des vestes en cuir, jeans et Doc Martens rivées aux pieds. Alors porter une robe, apparat absolu de la féminité, n’est pas vraiment pas quelque chose de naturel ; dans la chanson, une sorte de lutte s’installe, entre l’envie d’attirer la convoitise et le regard masculins, et le sentiment du grotesque, à tituber et trébucher dans une robe qui gêne, freine les mouvements. Pour finir par se retrouver harassée, souillée et stupide. Quant au son, il est dès le départ impitoyable, décharné et cru (ce mot reviendra souvent), blues et punk et grunge. Les décharges de caisse claire, qui clôturent le morceau, sont tellement sèches qu’un bref instant, ce sont des coups de fouets portés sur une surface métallique, striés par les crissements de sable aride du violon. La face-B, Dry, en laissera plus d’un ahuri, face à la brutalité du tableau, la frustration sexuelle maladive, littéralement vampirique :
I’m sucking ’till I’m whiteBut you leave me dry(Je [te] suce jusqu’à en devenir blancheMais tu me laisses sèche)
La presse s’emballe pour ce single peu aimable. John Peel le diffuse compulsivement sur les ondes de la BBC, et convie le groupe à participer à une de ses fameuses sessions. PJ Harvey joue maintenant à guichets fermés et se trouve écrasée sous les interviews. Un exercice nécessaire mais qu’elle supporte mal, oppressée par les journalistes en quête de confessions, d’analyses, de références. Toujours si réservée de caractère, décidée à ne rien céder sur sa vie privée, elle finit par se sentir mal à l’aise dans le cadre promotionnel, souvent distante, voire glaçante. Elle lancera à Antoine De Caunes, lors de son passage dans l’émission Rapido : « Si cela ne tenait qu’à moi, je ne serais jamais venue vous voir. »
Février 92, c’est Sheela-Na-Gig qui paraît en single. Le titre se réfère à des sculptures disséminées en Angleterre et en Irlande, représentant grossièrement une figure féminine absurde, aux yeux exorbités et à la tête proéminente. Les jambes tendues, on peut les voir écarter les cuisses et dévoiler exagérément leur vulve. Sheela-Na-Gig serait donc pour Polly un de ces portraits, largement outranciers et passablement réducteurs, auxquels peuvent avoir droit les femmes. Le morceau explore avec toujours autant d’efficacité la veine du blues travaillé aux crochets. En l’occurrence, les paroles peuvent se révéler parfois revanchardes, en se coulant, de manière détournée, dans le profil du sale type généralisant et maugréant à l’encontre des attributs féminins - les hanches fertiles, les lèvres vermeilles, les seins pesants :
He said "Wash your breasts, I don’t want to be unclean"("Lave-toi les seins, je ne veux pas que tu me salisses")
Avec ce succès, affluent les propositions de grandes maisons de disque (Island en particulier), toujours pressantes. Mark Vernon, le manager, insiste : Polly doit considérer ces offres, d’autant que Too Pure est une petite structure et qu’aucun contrat n’a été réellement signé. Elle se sent pourtant moralement liée à ce label qui a cru en son talent, qui l’a accompagnée dans son ascension. Dans le dos de son manager, un dimanche matin, elle signe avec Paul Cox pour son premier album à paraître, l’espace d’un rendez-vous calfeutré, censé échapper aux puissants qui guettent. Le disque en question a été vite enregistré à Yeovil, avec un budget dérisoire de 5000 livres sterling. Le titre est Dry. L’album paraît en mars.

- Dry
Sur la pochette, cette bouche en gros plan, pressée contre une vitre. Des teintes verdâtres, délayées dans l’ombre, du flou, du granuleux. La photo est prise par Maria Mochnacz, une amie photographe de Polly, rencontrée grâce à l’école d’art. Dry et les lèvres écrasées de Polly collent immédiatement une impression de sauvagerie prête à jaillir. C’est ce qu’est et ce que joue PJ Harvey : de la sauvagerie aux formes du blues, un blues calleux, rompu, où les guitares sont autant de griffures saccadées, la voix dans l’urgence des sentiments. « Quand j’ai enregistré Dry, j’étais contre toute production. Je m’étais présentée à l’ingénieur du son en lui disant : "Je ne veux aucun effet sur le son ou la voix. Enregistre uniquement ce qu’on joue". » C’est une révélation spontanée, comme l’impose l’accueil dithyrambique auquel il a droit. Une production parfois à bout de souffle, ne saurait limiter l’impact des compositions : Oh My Lover et sa supplique crue, le cauchemar aux éclats boisés de Plants And Rags, Water le déluge rocailleux, Dress, Victory… Plantée dans la frustration, le sexe, l’amour, les allusions bibliques, PJ Harvey dégage une insoumission impressionnante : « "Dry" était la première occasion que j’avais de faire un disque, et je pensais que ce pourrait être la dernière. J’ai donc mis tout ce que j’avais dedans. C’était un enregistrement très extrême. Je n’avais jamais pensé que je pourrais avoir cette opportunité, alors je sentais que je devais tout capter dessus, du mieux que je le pouvais, parce que c’était probablement mon unique chance. Ça a été une grande joie pour moi, d’être capable de le faire. »

- La couverture du NME en avril 92
Bombardé d’éloges, l’album connaît un succès considérable. La presse accourt, et PJ pose seins nus, mais dos tourné, en couverture du NME, ce qui déclenche une certaine agitation. Sa décomplexion apparente lui collent une image de salope, de furie, de vengeresse ; ou peut-être une féministe enragée, qui ne demande qu’à se déshabiller pour afficher sa liberté et son plaisir, et les plaquer contre l’ego masculin tout-puissant. Il est clair que Dry aborde de front la sexualité et la frustration. Crûment, sans compromission, Polly y dévoile des textes affolants de sensualité brutale, sans pour autant se sentir investie de quelconques revendications à l’égard des hommes. Il s’agit du sexe comme partie intégrante du sentiment amoureux, dans toute sa complexité physique et émotionnel, et non comme pur agent d’affrontement. Quand on l’interroge à propos de cette soi-disante nécessité de se mettre à nue pour vendre, Polly répond naïvement : « Pour moi, ces photos correspondent tout à fait à l’album. Cette nudité n’est pas la mienne, c’est celle de notre musique. Je ne pensais pas que cela ferait un tel scandale, ni qu’il y aurait des réactions aussi violentes. »
Wish You Leave Me
Pour la suite, une décision est prise : migrer sur Island. De manière un peu douloureuse pour Polly. Elle a envie d’avancer, et elle sait bien que Too Pure ne peut lui fournir les moyens pour épanouir sa carrière. Malgré tout, la séparation la perturbe. Pour Rob Ellis, « c’était impératif, le groupe devait aller de l’avant. Cela n’était plus compatible avec un travail normal. Il fallait bien pouvoir gagner de l’argent grâce à la musique. » Une fois le contrat signé, Dry va conquérir les Etats-Unis. Et le groupe d’entamer une grande tournée durant l’été, de Chicago à Paris. Des sessions studio pour le prochain album ont également lieu à Oxford, mais le résultat n’est pas concluant.
En fait Polly, bien qu’auréolée par la reconnaissance, et pouvant prétendre à une certaine assurance, est peu à peu contaminée par la dépression. Londres d’abord, qui l’angoisse, ses halos incessants de fer et de béton, qui la digèrent peu à peu. Le sentiment d’isolement, alors que la foule déborde constamment. Elle n’y est pas habituée et cela commence à l’affecter. Ça, et le succès brutal, le fait de se voir en photos dans la presse, surtout de se détailler, d’examiner les traits qu’elle n’accepte pas, qu’elle n’arrive pas à supporter. Il y aussi une rupture récente, dont elle ne se remet pas. Elle maigrit beaucoup. Des crises d’angoisse surviennent. Figée dans son malaise, c’est grâce à l’attention de ses parents qu’elle décide de revenir dans le Dorset, se ressourcer. Elle loue un appartement en bord de mer ; souvent seule, parcourant du regard les longues surfaces bleues crénelées qui s’offrent à elle, Polly médite sur son parcours, les fulgurances du succès - des désillusions de l’industrie musicale aux pointilleux raccourcis des médias. Aidée par un psychothérapeute, elle recouvre doucement une volonté jusqu’alors enfouie sous l’incertitude. Dorénavant, elle fera les choses comme elle l’entend et quoiqu’il en soit. « Maintenant que je suis en position de force, je vais en profiter pour refuser ce jeu stupide. Si je fais de la musique, c’est uniquement parce que j’aime jouer, pas pour me vendre. Ça ne m’intéresse absolument pas de voir ma photo dans les journaux. C’est très dangereux pour ma musique. Je voudrais pouvoir m’y consacrer beaucoup plus, ne pas ressentir ce dégoût, cette lassitude. »
Rid Of Me, son prochain album, a vu le jour pendant cette période de convalescence. Évidemment, la colère et le désespoir de Polly se sont jetés dans les chansons qu’elle a écrites. Au bout de deux mois passés à l’écart de cette agitation médiatique hautement périphérique, qu’elle en était venue à haïr, elle refait surface en octobre, par l’entremise d’une Peel Session. Elle y révèle quelques nouveaux morceaux. Une nouvelle tournée est lancée, où sont visités les Pays-Bas, l’Allemagne et en décembre, de nouveau les Etats-Unis.
La destination n’est pas totalement innocente, puisque c’est à Minneapolis que les attend Steve Albini, pour enregistrer Rid Of Me. Sa réputation de producteur sans compromis a déjà sévèrement percuté la fin des années 80 jusqu’à ces 90’s entamées, les Pixies, Jon Spencer, Wedding Present ou Jesus Lizard étant passés entre ses mains. On peut d’emblée distinguer son amour pour un son sec et brûlant, le credo "live in the studio". Albini se positionnant simplement comme un médium enregistrant le son d’un groupe, c’est ce que PJ est venue chercher. Les sessions débutent le 5 décembre aux Pachyderm Studios ; deux semaines plus tard, s’achèvent. Le groupe en sort satisfait, PJ appréciant « le silence dans lequel Albini travaille. Il te donne quelques pistes et puis il te laisse faire sans intervenir et sans t’interrompre. C’est très appréciable. » Avant de partir, Albini l’emmènera judicieusement sur la Highway 61, où ils prendront quelques photos avec Rob Ellis.

- Rid Of Me
Rid Of Me vient percuter le mois d’avril 93. C’est un album de crispation, intense et radical, qui mord l’espace ; Dry était insoumis, Rid Of Me est sèchement assommant. Pochette fascinante (toujours réalisée par Maria Mochnacz), où PJ se plante sous le regard, nue dans une salle de bains implacablement minérale, cadrée juste avant la poitrine, chevelure mouillée et jetée comme un arc métallique, fixée dans un mouvement de lame perçante et glacée. Le titre éponyme est probablement un des plus cinglants qu’elle ait écrit, renforcé dans sa tension par la production plombée d’Albini. D’une guitare minimaliste grattée sournoisement, moulée dans une frustration au ras des murs, Polly déploie un refrain bouillonnant ; un choc qui surgit comme une décharge cathartique, permet d’expulser enfin la rage liée à cette obsession, ce désir irrépressible, cette sexualité haletante qui sont le cœur de la chanson :
I’m gonna twist your head off, see’Till you say don’t you wish you never, never met her(Je vais t’arracher la tête, tu voisJusqu’à ce que tu dises que tu voudrais ne l’avoir jamais, jamais rencontrée)
Une sentence empruntée au Dirty Blue Gene de Captain Beefheart - jusqu’à ce que Rob Ellis ânonne d’une voix perçante, à la limite du supportable.
Lick my legs - I’m on fireLick my legs - of desire(Lèche mes jambes - je brûleLèche mes jambes - de désir)
Le blues est toujours le centre de gravité, rongé au sang qu’il est, rampant puis soudainement amplifié en un élan électrique libérateur mais guidé par le manque. Un blues de démangeaison, craché pour expulser un sexe animal, de sang et de malaise. Les titres parlent d’eux-mêmes : Rub ’Til It Bleeds (Frotte jusqu’à ce que ça saigne), Man-Size (La taille des hommes), Hook (Crochet)… PJ reprend également Bob Dylan (Highway ’61 Revisited). Elle impose pour de bon son style, amazone hargneuse, à la psyché tourmentée, sexualité terriblement primitive, même si de nature, elle se révèle assez réflexive. Lancé par le single 50ft Queenie, l’album connaît le succès, étonnamment (Polly avait confié à une amie, avant d’entrer en studio, que ce disque serait tellement abominable que personne ne l’achèterait.. et, en un sens, il l’est).
Nouvel album oblige, le trio entame de nouveau la route, Etats-Unis, Europe, Japon. Et puis, on leur propose d’assurer la première partie de U2 (eux aussi signés chez Island), pour la tournée "Zooropa". Une opportunité appliquée dès le mois d’août, même si l’accueil ne sera pas excessivement chaleureux ; parfois, le public leur hurle de dégager. Pourtant, le manager de U2, Paul McGuiness, est conquis par leurs prestations et propose ses services, dûment acceptés. « Cela a changé beaucoup de choses : il connaît son métier sur le bout des doigts. Et puis, je ne suis pas son unique source de revenus, ce que j’étais pour mon précédent manager. Alors, j’ai moins de pression. »

- PJ Harvey, période "Rid Of Me"
À l’occasion de cette tournée, Polly décide d’appliquer ses principes fixés post-dépression. Elle mène le jeu, coûte que coûte. Quand elle arrive sur scène, elle est parée d’un style outrancier : veste en fourrure léopard miteuse, lunettes de soleil aux montures plastifiées stridentes, boas en plumes fluos sur accessoires synthétiques, maquillage barbare encadré par cheveux lâchés et graisseux. Incarnation vulgaire, réminiscence de féminité pathétique, mais elle a décidé de s’amuser, intégrant une certaine assurance dans cette esthétique éventée. « Maintenant que je me sens plus à l’aise avec moi-même, je peux me permettre ce genre de choses. » C’est ici qu’elle amorce son précepte un album/un visage, dont elle ne déviera jamais ; l’importance des formes et des couleurs.
Entre-temps dans les coulisses, les tensions se déclarent et planent sur la solidité du trio. Disputes, tergiversations, rancoeurs bien communes. Polly se sent particulièrement emprisonnée par la rigidité de la formation, son caractère monolithique qui pèse sur l’inspiration et retranche la moindre spontanéité. « Pour chaque morceau je devais composer une partie batterie, une partie basse, ne pas laisser Steve et Rob sur la touche. C’était devenu un diktat insupportable. » La propension d’Ellis à s’impliquer toujours davantage ajoute à la paralysie, et finalement, bouscule la dissolution. Chacun part. C’est la fin de l’instant, PJ Harvey première formule. « C’était la meilleure chose à faire. Je suis consciente de leur devoir beaucoup : sans eux, "Dry" et "Rid Of Me" auraient été très différents, peut-être moins tranchants, moins rythmiques. Mais désormais, je ne m’imagine plus travaillant avec un autre songwriter, comme Rob, ou avec un groupe au format classique. » PJ est maintenant seule, face à son œuvre.
Red Rebirth

- 4-Track Demos
Évidemment, la tournée ne peut se poursuivre à l’automne et est annulée. Préférant éviter une projection immédiate dans sa création "à venir", Polly, sous la bienveillance enthousiaste de Steve Albini, décide de publier un recueil de quelques démos, préambules à Rid Of Me, parsemées d’inédits : en l’occurrence, 4-Track Demos, en octobre 93. En dehors de toute production, les morceaux ne sont pas là pour charmer un seul instant, il s’agit davantage d’électricité éraflée et aride, à la violence et dépouillement incroyables, des souffles de guitares d’angles décharnés et indomptés. À écouter 50Ft Queenie, dans sa version nue, menace de couper, de laisser des traces de sang sur son passage dans l’air ambiant. Parmi les titres inédits, Driving et Hardly Wait sont deux éclats de souffrance mélancolique, où PJ laisse place à une fragilité furieuse. Beaux moments d’émotion et de torture. En substance, 4-Track Demos puise sa raison d’être dans l’insatisfaction permanente de Polly à l’égard de ses albums. Un disque ne peut être que la cristallisation de ses émotions d’un moment, un faisceau de temps, de matière et de sentiments condamné à périr (ou à décevoir). Ne pas rester coincée dans la proximité insupportable d’une époque. Pour cela, 4-Track Demos a la valeur de l’intimité totale, celle qui aveugle un peu. Et puis, pour PJ, les démos ont leur place particulière dans la démarche créative. « En tant qu’auditrice, cela m’intéresse de savoir comment un artiste procède. Et maintenant, je travaille toujours comme cela : quand j’écris une nouvelle chanson, je l’enregistre immédiatement pour garder une trace du premier jet. Je trouve qu’après, quand tu retravailles sur un titre, tu risques de te concentrer sur les détails de finition et de perdre l’énergie et l’intensité initiales. »

- Björk et PJ Harvey, aux Brit Awards 1994
Passés ces prémices solo, Polly se retire pour un temps dans le Dorset, à la recherche d’une maison susceptible d’abriter le calme et la création. Elle s’y réfugie comme dans un secret, épanouie dans ce recueillement champêtre. Elle se livre à l’horticulture, lit beaucoup. Le temps s’écoule et en février 94, à l’occasion de la cérémonie des Brit Awards, on la voit soudain arriver sur scène, accompagnée de Björk. Elles reprennent Satisfaction à deux voix, guitare sourde et réduite à la plus simple ossature, minuscule clavier languissant. Le bonheur de les voir côte à côte ne peut effacer le sentiment que la chanson aurait pu être davantage travaillée, encore plus expansive. Les deux chanteuses sympathisent en coulisses, avec Tori Amos. Quelques mois plus tard, elles donnent toutes trois une interview au magazine Q, partageant leurs parcours, leurs musiques, leurs sentiments sur l’image qu’elles renvoient. Cela permet à Polly d’exprimer ses rapports conflictuels avec la presse, dus à sa volonté acharnée de préserver tout ce qui n’a pas rapport à sa musique, le domaine privé donc. « Je suis d’une nature assez réservée et les gens se font une fausse idée de moi. Tant pis ou tant mieux. Je n’ai pas envie que n’importe qui puisse me percer à jour facilement. »
Mais l’été arrive déjà, et pour Polly il faut maintenant construire quelque chose de différent. Instinctivement, suivre une autre direction, à travers laquelle elle pourra se révéler singulièrement, elle pourra renaître en tête à tête avec sa création, sûrement. Mais tout est encore incertain et brouillé pour le moment. Elle doit se mettre à écrire. Elle se coupe du monde dans sa maison du Dorset, perdue dans les collines étirées à perte de vue, dominant le paysage pour y puiser une force souterraine, une inspiration brute. Y ajouter des veilles insomniaques, où les rêves qui la traversent pendant les faibles heures où elle se relâche, suffisent à nourrir ses textes de symboles troubles et d’images fantasmatiques. American Psycho, de Bret Easton Ellis, qui, parmi tous les livres qu’elle absorbe avidement, la marque un grand coup. « Un livre aussi brutal que celui-là produit une sorte de fascination sur le lecteur. Il arrive même qu’on soit émoustillé par une scène de viol : ce sont des émotions intéressantes, mais difficiles à gérer et à assumer en tant qu’être humain. » Progressivement, les chansons arrivent, une vingtaine sont écrites.
Et finalement, l’étape du studio. Il est d’abord prévu de confier à nouveau la production à Steve Albini, mais sa radicalité sonore, son refus de tout arrangement qui avaient prévalu pour Rid Of Me, sont écartés, car Polly est à la recherche d’un son neuf. Elle veut que les chansons « respirent ». La rencontre avec Flood, et son travail de producteur avec Nine Inch Nails, Nick Cave et U2, la séduisent. Mais c’est aussi par John Parish que la renaissance s’opère. Grâce aux liens d’amitié qu’ils ont tissé depuis l’époque d’Automatic Dlamini, Polly le sollicite dans sa quête pour apporter une lumière singulière sur ses compositions. Parish se retrouve ainsi aux côtés de Flood pour façonner le son de To Bring You My Love. Une petite équipe est également constituée pour ces sessions studio, avec notamment Mick Harvey (un Bad Seeds) et Joe Gore (qui avait participé à plusieurs albums de Tom Waits), chacun assurant divers instruments, ainsi que des musiciens de formation classique pour les cordes. L’enregistrement se déroule pendant six semaines aux Townhouse Three Studios, à Londres. « Avec "To Bring You My Love", je suis passée pour la première fois au mode d’enregistrement classique, piste par piste, instrument par instrument. Pour la première fois, j’ai pu travailler à mon rythme, sans précipitation, en prenant soin des détails. »

Le disque est dévoilé en février 95, avec le single Down By The Water. L’impression première est limpide : un pas a été franchi. De la jeune fille rageuse et cinglante, il ne subsiste que des ombres vagues et imprécises. La voix de PJ ne se laisse pas déborder par des guitares tranchantes et des rythmiques sèches comme la poussière - elle laisse le soin des instruments aux autres pour se concentrer sur le chant. Et quand elle s’y met, c’est avec un timbre profond et acre, gorgé d’histoires d’amour flamboyant et de péché mortel. La place est à une tonalité luxuriante (arrangements soyeux, renvoyant aussi bien à un gospel amniotique qu’à des échos hispaniques et tragiques) mais encore rugueuse (le blues toujours, désertique, qui continue de se propager avec évidence et minimalisme). Le premier morceau éponyme théâtralise une profonde pulsation de guitare, d’une simplicité hypnotique, afin que PJ expie d’une voix caverneuse et saturée ses errements passionnels :
I’ve lain with the DevilCursed God aboveForsaken heavenTo bring you my love(J’ai couché avec le DiableMaudit Dieu davantageAbandonné le paradisPour t’apporter mon amour)
Mais chacun pressent que cet amour ténébreux ne peut être qu’une malédiction, pourchassant l’être convoité.

- To Bring You My Love
En définitive, To Bring You My Love est un album éperdument sensuel, quand Dry et Rid Of Me étaient tout bonnement sexuels. À elle seule, la pochette suffirait à le suggérer. PJ Harvey baigne dans une eau translucide, les traits offerts à une lumière irradiant le doux cadre bleu craie, et sa peau est d’une blancheur agressive, son corps dessiné par une robe en soie rouge dont l’éclat est alourdi par les froissements aquatiques ; on devine une pureté, une illumination. Cette femme fatale qui flotte à la surface a le visage lourdement maquillé, elle adopte quelque chose comme une sérénité lascive, mais sa posture, son abandon, sont bien christiques. Tout ce qui sous-tend le disque en somme, un entrecroisement de religion, d’amour, de désespoir et de violence. Organique et beau, une beauté qu’on aurait du mal à déceler chez les deux précédents. PJ ne renonce pas pour autant à sa complexité - quelques moments de fracas avec Meet Ze Monsta et Long Snake Moan, également ce Working For The Man qui suffoque à couvert, avec des basses de clavier vibrantes et étouffées, alors qu’elle paraît chanter en marge, insidieuse et inquiétante à travers une histoire de prostituée embarquée dans des voitures douteuses. Elle décroche même ce qui a l’air d’un hit avec Down By The Water (en rotation lourde sur MTV), mais une fois de plus, se fige dans le rejet face à cette composition qui ne lui appartient déjà plus : « Quand j’ai entendu "Down By The Water" programmé chez John Peel, j’ai trouvé que cela ressemblait à ce qu’on entend chez lui tous les soirs. Je ne sais pas pourquoi je me suis torturé l’esprit si longtemps pour pondre quelque chose d’aussi banal. »

Les critiques consacrent l’album en le liant à l’atteinte d’une maturité. Peut-être, inévitablement ne pouvaient-ils qu’en venir à ça, lorsqu’ils découvrirent PJ Harvey désormais pleinement femme. Ce changement d’apparence, c’est comme si elle voulait saturer ses attributs : rouge à lèvre luisant, fard vert, faux cils, les cheveux longs et lisses, elle adopte un style qu’elle dit avoir emprunté aux drag-queens, se perche sur des hauts talons avec, depuis tout ce temps, des robes, des vraies, rouges, longues et moulantes, aux couleurs vives et pailletées. La féminité qu’elle a du conquérir, à contre-courant, elle préfère s’en détacher et la grime dans ses excès les plus tapageurs et grinçants. Parée pour se prêter au jeu de la promo et des interviews, même si l’étape est encore plus ou moins pénible : « J’ai toujours un terrible sentiment d’insatisfaction quand une interview se termine, l’impression de ne pas avoir pu dire l’essentiel. Mais je suis aujourd’hui dans un état d’esprit beaucoup plus positif qu’avant. Je suis quelqu’un de très timide et, dans ma famille, on n’a pas l’habitude de parler beaucoup. Alors, quand on me pose des questions sur ma vie ou sur mon enfance, je me sens très mal à l’aise. Ma mère m’a fait écouter de vieilles interviews de Bob Dylan. Lui, il avait l’art et la manière d’emmener le journaliste sur son propre terrain. Je regrette de n’être pas aussi habile. »

- En combinaison rose fluo, au festival de Glastonbury
La tournée démarre en Angleterre et, comme sur album, Polly délègue la musique au groupe qui l’accompagne (John Parish, Eric Drew Feldman qui a travaillé avec Beefheart et les Pixies…), libre de se mettre en scène dans ses tenues de diva ravagée, de se lancer avec énergie dans les rythmes, maracas ou tambourins en mains, de donner à sa voix l’ampleur qu’elle souhaite. Préoccupée du choix des costumes et des lumières, elle est déterminée à camper ce personnage décharné mais électrique, parfois jusqu’à susciter le malaise, tant son visage surmaquillé peut s’effacer au profit d’un masque grinçant. Le public lui fait un triomphe, et en août elle embarque pour la suite des opérations vers les Etats-Unis, en première partie de Live et Veruca Salt. « Le défi me plaisait. D’un point de vue moral, cela me posait quelques problèmes de tourner en première partie de groupes pour lesquels, musicalement, je n’ai pas beaucoup de respect. Mais cela rend modeste : il ne faut pas oublier que les gens ne nous connaissent pas et se fichent de nous comme de l’an quarante, même si on travaille beaucoup. Cela demande une grande discipline. » Cette tournée de longue haleine est d’ailleurs l’occasion pour John Parish d’amorcer enfin un projet de collaboration avec la maîtresse de cérémonie. À la base, des éclats de mélodies qu’il enregistre sur un quatre pistes, le soir après les concerts, confiné dans sa chambre d’hôtel anonyme : elle est intéressée, il lui confie la cassette et les deux mettent au point un système. Lui s’occupe de la musique, elle des textes et du chant, enregistrant sa voix sur un autre appareil tout en écoutant les compositions. Dès qu’ils trouvent le moment pour en parler, affiner les morceaux, ils le font, en coulisses, à l’angle d’un couloir ou au bar.
Après plusieurs mois de va-et-vient entre métropole et aéroport, lumières aveuglantes et hurlements de masse, Polly commence à être envahie par la fatigue et le stress, au-delà de ses limites. Elle fait le point sur la tournée qui touche à sa fin : « Toute cette mise en scène de ma musique a été pour moi l’occasion de me cacher. Au fond, je crois que je me suis perdue. Je veux revenir à quelque chose de plus dépouillé et me recentrer sur mes chansons. » Ce constat aux allures de coup de grâce, la conduit à annuler les dernières dates prévues, pour enfin regagner l’Angleterre, se feutrer dans la solitude.
Lost In The Sound
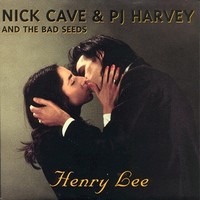
- Henry Lee
À peine a-t-elle le temps de récupérer, ou profiter des immensités dépeuplées du Dorset, qu’elle se voit contactée par Nick Cave. Une providence. Elle l’avait rencontrée peu auparavant, grâce à Mick Harvey (un partenaire depuis son premier groupe Boys Next Door, jusqu’aux Bad Seeds) et Flood (qui a produit The Firstborn Is Dead). Il lui propose de venir chanter sur Murder Ballads, l’album qu’il prépare. Tout est dans le titre : des meurtres contés dans de sombres ballades. Cave a réuni pour des duos Shane MacGowan, des Pogues, et l’improbable Kylie Minogue. Son univers fait tellement écho au sien, son titre From Her To Eternity l’a à ce point émue, qu’il est impossible que Polly ait hésité. Henry Lee, la chanson pour laquelle elle est sollicitée, la peint en amante abandonnée, préférant poignarder son tendre Henry, plutôt que de le laisser s’échapper aux bras d’une autre. Le morceau est doux, étonnamment tendre, calmement mélancolique. La voix de Polly est résignée, dans un registre contenu mais émouvant. Lorsqu’il est édité en single, au mois de février 96, Nick et PJ s’embrassent, dans une ultime étreinte d’amants maudits, sur la pochette aux sombres teintes d’adieu.
Après une telle image, apprendre qu’ils sont tombés amoureux ne relève pas vraiment de la surprise. « On se ressemble énormément, c’est sans doute mon meilleur ami. On partage les mêmes doutes et les mêmes joies aussi. Il a une intelligence très vive, il m’a ouvert les yeux sur des aspects de ma propre personnalité que je n’avais jamais perçus auparavant. » Peut-être l’alchimie du duo avait-elle dissous les limites du pur cadre artistique pour contaminer les sentiments. Peut-être… En tout cas, Polly emménage dans l’appartement de Cave, à Chelsea. Ils assurent la promotion de la chanson pendant les deux premiers mois de 96, l’interprètent pour le show TV "The White Room", tournent un clip. Et Polly de s’interroger sur sa carrière, incessante analyse qui revient en creux, dès l’abandon d’un album pour l’amorce d’un autre. Elle désire prendre ses distances avec ce microcosme relativement dérisoire des maisons de disques, studios et tournées, obligations promotionnelles. Au fond, sa musique a-t-elle vraiment besoin de s’y soumettre pour exister ? Elle songe : « Récemment, j’ai beaucoup pensé à Tom Waits et à la façon dont il gère sa carrière. Il ne court pas après l’argent ni après le succès, mais il fait ce qui lui plaît. Il touche un peu à tout : il fait l’acteur, il écrit des scénarios ou des musiques de films. » Elle aussi convoite cette liberté, là où un parcours se construit sur l’unique désir total de création, et non par rapport à des impératifs de rendement. Un panorama idéal où elle pourrait ne pas entendre, à son propos [un critique de l’époque]
: « C’est un génie dans son domaine, mais ce n’est pas une bombe sexuelle comme Courtney Love ou Alanis Morrissette. Elle est donc moins vendeuse. »

- Nick Cave et PJ Harvey
Retour aux chansons composées avec Parish, pendant la tournée de To Bring You My Love. Étant achevées, John et Polly décident d’entrer en studio à Yeovil pour leur donner corps. L’enregistrement prend un mois, mi-mars l’album est prêt. Le temps d’en planifier la promotion et la sortie, Polly commence à travailler sur de nouvelles compositions. Mais simultanément, elle met un terme à sa relation intense et agitée avec Nick Cave. Une rupture brutale guidée par des motivations troubles, à en croire la réaction d’un Cave sur le carreau, qui se réfugiera en studio pour graver sa douleur dans le son de The Boatman’s Call. L’album d’un ton recueilli, minimaliste et solennel, est tout entier dévoué à sa peine et ne dissimule pas son évocation de la responsable, à travers West Country Girl, Far From Me, Black Hair, tour à tour profondément nostalgiques et d’une cruauté blessée.
Quant à elle, Polly préfère s’exiler vers le Dorset, pour éviter les possibles échos médiatiques de cette histoire. Elle-même est inévitablement affectée par cette séparation. Possible prélude à une période où elle se jette à corps perdu dans de multiples collaborations, renouant avec son ancien partenaire Rob Ellis pour chanter sur deux titres de son projet Spleen (l’album Soundtrack To Spleen paraît en juillet), se faisant interprète pour des musiques de films (Who Will Love Me Now ? pour le générique de fin de The Passion Of Darkly Noon, de Philip Ridley, ainsi que This Is Mine pour l’anonyme Stella Does Tricks, de Coky Giedroyc). Elle présente également quelques-unes de ses sculptures, à l’occasion de l’exposition "Freezeframe" à Londres : « Il n’y a rien de précieux là-dedans, rien de sérieux non plus. En tant qu’auteur, j’ai souvent tendance à être trop sérieuse. Pour moi, la sculpture est un défouloir, un moyen de me détendre. »
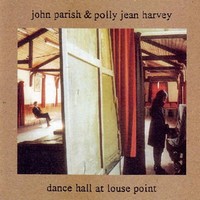
- Dance Hall At Louse Point
Enfin, l’album partagé avec John Parish, Dance Hall At Louse Point, sort fin septembre 96. Volontiers tétanisant, parfois proche de l’hystérie, il constitue sans doute l’œuvre la plus expérimentale et radicale de PJ Harvey jusqu’alors. C’est une communion dérangée entre le blues malade et strident écrit par Parish et les textes égarés, le chant rarement aussi ouvert de Polly. Chaque titre est annoté du nom de la ville où il a été composé (via la tournée). Lames de lumière industrielle ou dépouillement de rase campagne, tout se tient. Avec ses guitares infectées, Parish pousse PJ dans des retranchements insoupçonnables : City Of No Sun lui arrache une voix de cauchemar, criarde et haut perchée, terreur aiguisée de rouille et de mort. Dans Taut, sûrement le titre le plus impressionnant, elle murmure dans l’urgence, comme si elle était traquée, un souvenir traumatique, arraché par l’hypnose, avant de s’étrangler " Jesus, save me ". Et Civil War Correspondent, complainte au timbre grave et étiré, tout juste tressaillant dans l’enveloppe timide de clavier, prodigue une émotion incroyable de profondeur. PJ Harvey n’avait peut-être jamais autant joui de cette liberté de moduler sa voix, guidée par des états d’âme violents et abyssaux. Et puis, bien qu’on puisse ordinairement attribuer à Dance Hall At Louse Point une écoute difficile et exigeante, la mélodicité chaotique de Parish - faites de triturations de guitares blues crénelées et bouillantes, la maigre présence de rythmiques osseuses - est autant en droit de séduire par sa force abrasive que par sa singularité et son intransigeance. De même, le disque énonce très clairement, dans la carrière de PJ, cette volonté d’affranchissement enragé qui la soutient depuis le début. Le monde a beau lui crier son talent et la pousser au succès, elle suit son instinct, farouchement indépendante.
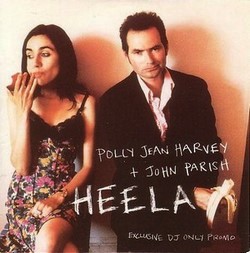
Cette collaboration jusqu’au boutiste est reçue avec négligence voire indifférence. Du fait de la double signature (apparaissant en toutes lettres sur la pochette), on préfère y voir un side project de Polly sans plus d’intérêt, John Parish étant majoritairement inconnu et ne méritant pas, sur la seule foi de son nom, qu’on y accorde une attention particulière. La maison de disque, Island, préconise "un suicide commercial" et tente tant bien que mal de rattraper les gains en publiant Is That All There Is ? en single, une des chansons les plus apaisées de l’album. Polly, toujours vigilante du plein contrôle de son œuvre, est furieuse de ne pas avoir été consultée pour cette décision et s’y oppose, bien qu’un clip ait été tourné et soit déjà diffusé. Elle fait tout pour imposer sa volonté et finalement, décide de s’arrêter sur That Was My Veil (elle aussi recueillie, et plutôt dépouillée) pour single attitré. La promotion du projet reste malgré tout assez calamiteuse, Polly profitant de l’occasion pour déléguer à Parish le seul soin des interviews, ce qui laisse la presse dubitative. Une mini tournée s’enclenche envers et contre tout début octobre, où Harvey et Parish retrouvent avec bonheur sur scène Eric Drew Feldman et leur ancien complice d’Automatic Dlamini, Jeremy Hogg.
Après ces histoires de diffusion houleuse et de concerts éclairs, Polly éprouve le besoin de se confronter à ses propres chansons. Maintenant, que peut-elle dire ? Et avec quelle musique, quel son ? Sa soif d’insaisissabilité, de régénération, sa fragilité rude, où la mènent-elles ? Le malaise gronde. Elle rentre en studio pour entamer quelque chose, en ressort vite. Des quelques morceaux composés jusqu’à maintenant, il y en a qui se nomme My Beautiful Leah. Un jour, un soir - on imagine la scène - Polly examine nerveusement les textes écrits depuis quelques mois, avec attention, elle déchiffre les griffonnements au crayon de papier, un par un peut-être, ou pas du tout, elle tombe distraitement, par un coup d’œil lancé négligemment par dessus le bureau jonché de pages noircies, sur les paroles de My Beautiful Leah, le deuxième couplet :
She only had nightmaresAnd her sadness never liftedAnd slowly over the yearsHer lovely face twisted(Elle ne faisait que des cauchemarsEt rien ne pouvait soulager sa peineEt peu à peu au fil des annéesSon joli visage se déforma)
Un vertige, quelque chose d’horrible. Tout devait se concentrer fatalement dans ces quelques lignes, un pan de son être, noir et insondable, un autre, un adversaire, un ennemi. Ces mots la mordent, comme un acide, terrible violence. Ils doivent parler d’elle, et si jamais c’était vrai, son visage transformé par le mal-être, des traits crispés à jamais en une expression de tristesse, de haine et de malheur. Interpellée, le constat est faible. Polly y perçoit un appel à l’aide, un hurlement si profond de détresse. « Quand j’ai entendu ces paroles, je me suis dit que ça ne me ressemblait pas. J’ai su alors que j’avais besoin d’aide. J’avais envie qu’on m’aide », dira-t-elle plus tard. Sur le point de plaquer sa carrière, tant elle pressent qu’elle ne fait qu’y explorer le gouffre de son désespoir et de sa noirceur, Polly contacte ses amis les plus proches, John Parish, Flood, Maria Mochnacz. Tous, avec bienveillance, lui conseillent de prendre du recul. Pourquoi pas partir ?
Ce qu’elle fait, en s’échappant aux Etats-Unis. Elle décide de suivre un parcours. Partant de San Francisco pour remonter la côte ouest, avec des amis et une voiture louée, elle campe dans des endroits désolés et sauvages, loin des repères de la campagne anglaise, pour finalement aboutir vers le Midwest. Le périple lui offre le temps de la réflexion ; elle fait le point, patiemment. Le goût de l’abandon dans ces reliefs inconnus, ces arides infinités menacées par la pesanteur du ciel, et la fuite de toute réflexivité maladive l’apaisent. Trois mois passent et elle revient plus sereine à Bristol, pour emménager un temps chez John ou Maria. En leur compagnie, elle se trouve armée pour poursuivre l’élaboration de cet album difficile.
She Saw Sunset
À une distance désormais supportable de ses tourments, Polly reprend ses compositions là où elle les avait laissées quelques mois plus tôt. Elle renoue aussi avec ses habitudes de collaborations effrénées : en septembre 97, elle fait une apparition dans un court-métrage de la réalisatrice Sarah Miles, enregistre avec Eric Drew Feldman Zaz Turned Blue pour la compilation Lounge-A-Palooza, tandis que parait September Songs, un tribute à Kurt Weill où figure sa reprise Ballad Of The Soldier’s Wife. Puis, à peine 1998 entamé, il y aura le duo avec Tricky, Broken Homes (sa voix étonnamment distante constitue un bel attrait), deux titres co-écrits avec Pascal Comelade, pour L’Argot Du Bruit (Green Eyes et surtout Love Too Soon, où elle s’essaie au transport romantique le plus désuet, avec talent). Sans compter le film de Hal Hartley, The Book Of Life. Parlons-en d’ailleurs.
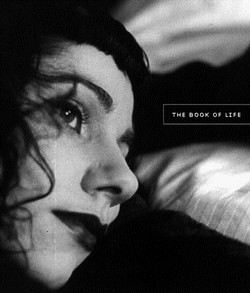
- The Book Of Life
Ce réalisateur new yorkais indépendant avait fait sa connaissance en 1995, alors qu’il souhaitait inclure la chanson Water dans son film, Amateur. Depuis, une relation amicale s’était noué, et Polly découvrant avec intérêt sa filmographie, lui soufflait son envie d’obtenir un rôle dans un de ses films, mais sans trop y croire. Pourtant, à son retour des Etats-Unis, elle est contactée par Hartley, qui lui propose de participer à un projet ; c’est une commande d’un producteur français, une collection de films réunissant dix réalisateurs sur le thème du passage à l’an 2000. Polly reçoit le scénario et accepte, exaltée.
Malheureusement, The Book Of Life est au final profondément laid et ennuyeux. Polly y incarne Marie Madeleine, accompagnant Jésus (Martin Donovan) lors de son arrivée à New York, à la veille du nouveau millénaire. Le scénario n’est pas le pire, bien qu’il se résume à de ridicules divagations new age - une vague histoire de troc avec le Diable, convoitant un… disque dur biblique, parsemée de joutes mystiques plombées au Valium, dans des halls d’hôtel désertés ou au comptoir d’un bar, ce genre de réjouissances. Mais surtout, le film est d’une incroyable laideur. Constamment alourdie par une esthétique indigeste, l’image est soumise tout du long à une espèce de ralenti traînant, qui fait horreur, au même titre que la photo baveuse et les cadrages obliques. Tout donne la sale impression de regarder un très mauvais téléfilm des années 80. La prestation de PJ reste discrète et s’efface dans le naufrage, la seule mélancolie charmante de son visage ne suffisant pas à accrocher les fanatiques les plus éperdus. D’ailleurs en y songeant, l’unique mérite du film est de ne leur être absolument pas destiné (contrairement à certains, où l’on sent que tout converge vers l’apparition de la "rock-star"). The Book Of Life ne succombe pas à cette logique et suit sa propre voie, aussi pénible soit-elle.
Outre ces tentatives cinématographiques, Polly avait réussi à compléter les chansons de son futur album, et à leur imposer une vision nouvelle. Toujours guidée par son désir de se plier à des formes différentes, la couleur de sa mutation était désormais fixée ; elle entre en studio à Londres en mars 98, avec peu ou prou la même équipe que pour To Bring You My Love, Flood à la barre, assistée par John Parish, Eric Drew Feldman, Mick Harvey mais aussi le compagnon des débuts, Rob Ellis. Pour l’enregistrement, Polly s’ouvre à de nouvelles techniques. Elle a depuis peu découvert la musique électronique, grâce à un ami, et n’y ayant jamais vraiment prêter attention auparavant, se révèle captivée par ces sonorités. Ce sera donc par cette avancée dans un style presque inconnu pour elle, que se jouera le renouveau de son approche. Une fois les sessions complétées, Polly se consacre à ces fameuses collaborations évoquées plus haut. Le reste du temps, elle flâne en bord de mer, près de ce nouvel appartement qu’elle vient d’acquérir, puisant l’inspiration dans les éléments marins - comme en témoigneront les illustrations du futur album.

- Is This Desire ?
Et lorsque Is This Desire ? sort en septembre 98, c’est un nouvel éveil. Un son, inédit chez Polly, qui assume sa duplicité. À l’image de sa personnalité sans cesse tendue vers la lumière sans pouvoir renoncer à l’obscurité, l’album alterne des titres très mélodieux (pop, sans ambiguïté) et d’autres étouffants et sourds, où le malaise est prégnant. Cette confrontation est perceptible jusqu’à la pochette, où il y a deux PJ Harvey, dos tourné l’une à l’autre, annonçant la dissemblance. S’il n’y avait ces titres anxiogènes, Is This Desire ? aurait incontestablement été un album pop (même très mélancolique), celui où Polly s’ouvre à la beauté simple de sa voix (elle chante ici avec quelques-unes de ses plus belles inflexions), à des dominances de claviers apaisés, concentrés sur l’émotion plutôt que sur l’énergie : Angelene et ses accords tendres et sereins, The Garden d’une pureté bouleversante, ou encore Catherine, dans laquelle elle traîne une affliction et un éloignement à peine reconnaissables. Au lieu de cela, un courant morbide menace de l’emporter, qui reconnaît dans des textures synthétiques et industrielles une nouvelle voix pour s’exprimer, là où les guitares deviennent impuissantes. Des prénoms féminins hantent les titres, ceux d’héroïnes perdues, Angelene, Elise, Catherine, Leah, autant de destins à choisir. Des basses grondantes et saturées n’ont même pas le courage d’élever le ton (Electric Light) et des rythmiques de tôle et de carnage (Joy) ruinent à jamais les rêves d’apaisement.
L’ultime dualité de PJ se dessine : doit-elle succomber à sa part d’ombre, à cette ennemie en elle qui l’anime dans sa création noire, ou se laisser définitivement entraîner vers la clarté et la sagesse ? On pressent que Is This Desire ? se construit sur cette incapacité à trancher. Et de cet éloignement définitif des origines (hormis peut-être sur la chanson titre, le blues des débuts n’est jamais convié), de cette quête presque existentielle sur laquelle est né l’album, émerge une sorte d’accomplissement dans la carrière de Polly, qui s’il n’est pas fondamentalement musical, constitue une apogée personnelle, de l’aveu même de l’intéressée : « Ça a été un album très, très pénible à réaliser et encore aujourd’hui il m’est difficile de l’écouter, mais de ceux que j’ai fait, c’est probablement celui que je préfère, car il a vraiment des tripes. Je créais une musique extrêmement dure, j’expérimentais des techniques que je n’avais pas utilisées auparavant, et je ne me souciais vraiment pas de ce que les gens allaient en penser. Je suis assez fière de cet album-là. »

La presse lui réserve malgré tout un accueil plus mitigé qu’à l’accoutumée. Certains désarçonnés lui prêtent un changement de cap chichiteux, voire abscons. Les ventes seront effectivement moins bonnes que pour To Bring You My Love. Attendait-on encore d’elle de la frustration, de la sexualité, la sauvagerie de la jeunesse ? Non, en 1998, Polly était plus encline au romantisme. Elle avait mûri, inévitablement. La tournée européenne, qui se mit en place dès octobre, la montra sereine. Certes, son visage pale était sèchement prononcé par une frange très courte, sa maigreur la fragilisait toujours (on la dit anorexique à l’époque). Mais Polly n’avait plus recours à un personnage, comme en 95. Revenue des affres, elle était simplement concentrée sur les nouvelles chansons, les réarrangeant pour les besoins de la scène en saccades puissantes. Entourée des immuables John Parish, Rob Ellis et Eric Drew Feldman, les guitares blues s’imposèrent de nouveau, venant donner de l’ampleur et du volume à des titres qui, sur album, versaient dans le squelettique et les basses ronflantes. Joy revenait à la terre, The Sky Lit Up devenait une incantation pleine de vigueur. Ces chansons cessaient d’être des fantômes et prenaient corps dans le crépuscule, pour conjurer la douleur et la faiblesse.
Trois mois plus tard, la tournée prend fin. Une page est tournée, Polly le sait. Il lui faut un départ radical. De nouvelles fondations, de nouvelles images desquelles s’imprégner. Cette fois-ci, le changement survient de manière géographique.
Manhattan
Début 99, Polly emménage à New York, dans un appartement près de Riverside Park. La ville ne lui est pas entièrement étrangère, puisque des visites à son ami Hal Hartley, mais aussi le tournage de The Book Of Life, lui ont permis de découvrir ses immensités, et d’en apprécier le pouvoir. New York exerce sur elle une attraction nouvelle. D’habitude angoissée par les grandes villes, Polly se sent étrangement apaisée au milieu des formidables altitudes de verre et de métal. « Les amis que je me suis fait à New York ne comprenaient pas pourquoi je trouvais si beaux les buildings, surtout au lever ou au coucher du soleil. J’ai traversé Manhattan comme j’aurais traversé la plus belle des forêts. C’était nouveau pour moi. » Pour la première fois peut-être, la vie urbaine se révèle fluide et inspiratrice, porteuse de sens. Elle se plonge dans le fourmillement culturel propre à Big Apple, avide de découvertes et d’expressions nouvelles. Le slam la stimule, elle apprend le flamenco, se passionne pour la scène locale (en particulier Tiffany Anders, une jeune artiste dont elle produira l’album). Elle fait également la rencontre de Vincent Gallo, qui deviendra un ami cher ; la presse leur prête alors une relation amoureuse, mais les deux démentiront. Elle sort beaucoup, jamais statique, virevolte d’un horizon à un autre comme pour mieux oublier Is This Desire ? et son âge de mort.

Durant neuf mois, en absorbant l’énergie de la ville, elle exploite cette matière inédite à travers des compositions neuves. Lorsqu’elle écrit, c’est instinctivement que Polly reflète le cheminement de son existence. Puisqu’elle se sent libérée, sa musique l’est forcément. Et puisqu’à New York, elle éprouve vraiment, sur un plan sensuel, les évènements qu’elle rencontre, son prochain disque sera tout sauf réflexif.
Galvanisée, elle repart aux premiers mois de 2000 pour le Dorset afin de continuer l’écriture, de ce qui commençait à devenir une évidence : « Je veux que les mélodies s’envolent, et que le son soit pur et parfait. » L’enregistrement se déroule de mars à avril, au Great Linford Manor près de Londres. Polly y est accompagnée par Rob Ellis (qui a décidément renoué avec elle) et Mick Harvey. Effectif réduit à un trio, comme aux débuts, pour faire l’épreuve de la simplicité. Parmi les nouveaux titres il y a un duo, qu’elle a composé avec en tête la voix de Thom Yorke. Radiohead est alors à quelques kilomètres de là, en studio pour Kid A, et Yorke accepte de venir la rejoindre. « C’est l’un des rares chanteurs qui m’émeuvent profondément, il a une voix incroyable. Au départ, je voulais lui écrire une chanson, ce que je n’avais jamais fait auparavant, pour personne. J’ai écrit la chanson alors que je ne le connaissais pas. » L’entente est si bonne que Thom s’attarde pour placer quelques lignes de claviers et parties vocales sur deux autres titres, One Line et Beautiful Feeling.
Une fois achevé, Polly ne tarde pas à reprendre le chemin des studios afin de participer à l’enregistrement de It’s A Wonderful Life, le nouvel album de Sparklehorse. Toujours captivée de se voir transportée dans des univers différents, elle se plie une fois de plus avec bonheur aux visions de son alter ego, dont elle ne connaît pas les lois mais auxquelles elle apporte sa personnalité. Elle n’est pas la seule à être convié, Tom Waits, John Parish et Nina Persson des Cardigans sont également présents. Sa curiosité vis-à-vis du processus créatif de ses pairs se trouve une fois de plus rassasiée : « En travaillant avec Sparklehorse, j’ai vu comment ils utilisaient leur équipement, comment ils trafiquaient les sons, comment ils enregistraient les voix. Très différent de ce que je faisais. Depuis, j’ai produit le disque d’une fille [Tiffany Anders, NDLR] en utilisant des idées que j’avais découvertes chez Sparklehorse. » Elle apparaît notamment sur Piano Fire, avec une guitare mortelle, dans un tissu lo-fi grésillant où on identifie à peine sa voix ; et sur la ballade résignée Eyepennies, Mark Linkous susurrant la tristesse comme à son habitude.

- Stories From The City, Stories From The Sea
Stories From The City, Stories From The Sea, est publié fin octobre. Comme tous ceux de la carrière de PJ Harvey jusqu’alors, c’est un album de "première fois" : le son est clair et libéré, et dévoile le visage insouciant de sa créatrice. Pour la première fois. Nouvelle parure chic et sensuelle ; PJ semble s’être détachée de ses angoisses pour imposer des chansons qui gagnent en simplicité. Si album pop il doit y avoir, ce sera celui-là. Refusant la noirceur et les dédales synthétiques du précédent opus, c’est dans la limpidité des guitares et leur vigueur qu’elle trouve la force de se révolter et d’haranguer un auditoire inconscient (Big Exit) : " This world’s crazy, Give me the gun ". Ses peurs et sa mélancolie restent couchés sur papier mais n’arrivent plus à dominer. Polly les astreint à une énergie, une évidence qui les font désormais plus tenir de la combativité que du pessimisme résigné. Ce sera finalement la lumière qui l’aura emporté.
Rock débordant, ballades ouvertes, aérien et pesant Stories From The City, Stories From The Sea sait conjuguer les humeurs introspectives de la mer (Beautiful Feeling) avec les hauteurs fracassantes des buildings (The Whores Hustle And The Hustlers Whore). This Mess We’re In, le duo avec Thom Yorke, est une belle scène d’adieu romantique ; l’ultime rencontre des deux amants, qui du haut de leur tour de verre surplombent la ville, alors que l’aube sonne le départ inéluctable. Leurs deux voix s’unissent sans jamais déborder, donnant au tableau son cachet éphémère et précieux. Polly prend son envol sur le titre final, une nouvelle résolution sur les lèvres : " We float, Take life as it comes ". La recherche de cette simplicité mélodique, refusant de se laissant piéger dans des arrangements froids et violents, se sent partout. Peut-être s’agit-il de son album le plus chaleureux. Sa grande faiblesse, pour quelques critiques. On y décèle une volonté de se rendre plus accessible, en gommant les aspérités et en privilégiant le tape à l’œil et le glamour. Clairement, l’asphyxie n’est plus de mise, ce qui fera de Stories… un succès commercial dans la droite lignée de To Bring You My Love.

Sempiternelle promotion. Polly décide de se prêter au jeu. À 30 ans passés, elle semble assurée de sa séduction. La ville lui aura peut-être appris à se glisser dans des robes aux coupes échancrées. Son visage paisible offre dans les pages des magazines comme un air de défi : "Auriez-vous jamais pensé que je puisse être si sexy ?" Le plébiscite rencontré par son album (les Etats-Unis sont conquis pour de bon) ne doit pas être étranger à cet aplomb et sérénité inhabituels. La tournée est triomphale, quelques nominations dans des cérémonies de prix huppés achèvent de parfaire une aura de reconnaissance qui lui sied bien au teint. Pour un peu, ces instants de quasi gloire lui assureraient une route tracée vers les sommets de la pop internationale. Mais c’est sans se rappeler l’essentiel.
Never Repeat Myself
Au final, il n’y a que ça : un parcours qui refuse d’être prévisible. PJ Harvey déteste ressembler à ce qu’on attend d’elle. Elle ne veut pas être percée à jour et cet album l’installe un peu trop dans le confort artistique.
Le temps va encore filer, les collaborations aussi (les Desert Sessions de Josh Homme, le nouvel album de Marianne Faithfull pour lequel elle compose quelques titres). Et lorsqu’elle reviendra, en 2004, elle essaiera de changer. Face au scintillant Stories..., le sous produit Uh Huh Her. Les chansons ont été enregistrés chez elle, elle y joue de tout, sèchement (sauf la batterie, elle enverra les bandes à Rob Ellis afin qu’il y ajoute ses parties). Mais la frappe était éventée. Polly voulait se dérober au prédictible, avec des bouts de ficelle d’autrefois : violence sexuelle, brutalité blues. Le message était clair, "je ne me calmerai jamais". Mais les chansons trop peu correctes.
Quatre années passeront et en septembre dernier, Polly nous aura livré White Chalk, son album le plus fragile depuis longtemps. Un abandon à la mélancolie sur les touches d’un piano poussiéreux, où sa voix atteint des prouesses de désoeuvrement. Une preuve de plus, s’il en était besoin, qu’elle reste guidée par une incroyable envie de se recréer tant qu’elle le pourra.
Article initialement publié le 20 novembre 2007.



























Vos commentaires
# Le 19 juin 2012 à 15:51, par Julie En réponse à : PJ Harvey, My Sweet Enemy
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
