Dernière publication :
mercredi 15 avril 2015
Rechercher
par mot-clé
par index

Visages du classic rock
ou comment égotisme sans esthétisme n’est que ruine de l’art
par Emmanuel Chirache le 24 février 2009
Pochettes parues entre 1970 et 2008.




Avez-vous déjà remarqué à quel point les tenants du "classic rock" (terme à employer avec des sanglots dans la gorge) s’échinent à nous livrer les pires pochettes de l’univers ? Parmi ces artistes, certains sont d’anciennes gloires sixties ou seventies ayant quitté le groupe qui leur a valu de figurer au panthéon du rock pour se lancer dans ce qu’il est convenu d’appeler l’aventure en solo, poussés qu’ils étaient par une ambition dévorante, un peu de mégalomanie et beaucoup de lassitude. D’autres ont quant à eux toujours évolué en cavalier solitaire, au gré de leur inspiration. Quoi qu’il en soit, la plupart d’entre eux ont réussi à conserver un embryon de public au-delà des maudites années quatre-vingts, pourtant si cruelles à leur égard, sans pour autant connaître à nouveau l’immense réussite de leur prime jeunesse. S’ils ont survécu après la mort de l’âge classique du rock, ces chanteurs n’en ont pas moins souvent tué l’art de la pochette de disque, affichant chacun leur vilaine trogne dans toutes les situations imaginables. En voici un petit aperçu, preuves à l’appui.

- David Gilmour
La base, donc, le fondamental de la photo estampillée "classic rock", c’est le visage. Cet opus de David Gilmour datant de 1984 s’appelle d’ailleurs About Face, ça tombe bien. Ici, David fait de l’auto-stop, un geste encore suffisamment humble pour nous faire abdiquer toute velléité moqueuse. On pardonnera donc à l’ex-Pink Floyd ses penchants égocentriques, tout comme on pardonnera à Iggy Pop sa pochette de Avenue B pour avoir osé se présenter à nous à la sortie du bain. Face à l’appareil, les yeux dans les yeux avec son fan, telle se conçoit l’imagerie de la star en solo.

- Iggy Pop
La tronche décharnée et mal peignée d’Iggy reste néanmoins une exception. Pour ajouter une touche de glamour, on penchera plutôt vers la photo noir et blanc et la pose de beau gosse, à l’instar du Eric Burdon de My Secret Life. Bagouse bling bling et regard perçant, la voix des Animals nous scrute le regard intensément.

- Eric Burdon
On peut aussi se la jouer star du poker Texas hold’em avec lunettes noires et chapeau de marshall. C’est le cas de Van Morrison et de ses grosses mains qui semblent faire la donne. Depuis l’époque des Them, le bonhomme a un peu pris du poids... Pay The Devil dit le titre, un programme aussi alléchant que son illustration.

- Van Morrison

- Sting
Le visage donc, encore et toujours, n’importe comment, n’importe où. Dans un ascenseur comme Sting en 1999. Une bien belle pochette. On lui préférera cependant les timides essais esthétiques de Calvin Russell et Ray Davies, lesquels ont choisi de se confronter à leur propre reflet sur, respectivement, A Man In Full en 2004 et Working Man’s Cafe en 2007.

- Ray Davies
La vitrine fait alors office de médiateur entre notre regard et celui de l’artiste, sorte de posture post-moderne qui nous raconte combien personne n’est dupe : on a beau se regarder en face, un fossé nous sépare, celui du simulacre et du spectacle.
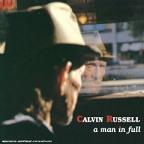
- Calvin Russell
Ou encore : vous croyez me connaître, mais vous vous leurrez, c’est une représentation de moi-même que vous adorez, une simple portion de ce que je suis, celle qui occupe le devant de la scène. Comme pour conjurer ce malentendu, Calvin Russell intitule son album A Man In Full (« un homme en entier »). En matière de distanciation, le maître absolu reste sans aucun doute Roger Daltrey, chanteur des Who de son état, qui se paie le luxe de nous tourner deux fois le dos sur One of The Boys (1977), sa troisième réalisation solo.

- Roger Daltrey
La crinière bouclée la plus célèbre du rock se mire en effet dans un miroir qui renvoie son verso au lieu du recto, absurdité plutôt amusante qui emprunte ses codes à l’univers surréaliste de Magritte, en particulier à sa toile La reproduction interdite de 1937. Tout comme la pochette de Daltrey, cette œuvre fait référence à l’obligatoire déformation des êtres et des choses opérée par l’art.

- La reproduction interdite de Magritte
Loin de reproduire la réalité, l’esthétique en pénètre différemment l’essence. Ni le public ni l’artiste ne peuvent donc contempler cette image de face, comme si l’essentiel fuyait notre regard.

- Phil Collins
Brouiller les pistes, multiplier les existences, se dérober à la vue de tous, voilà ce que désirent les rockers. Que ce soit de profil comme Phil Collins dans Hello I Must Be Going (1982), en doublon comme Mick Jagger sur Wandering Spirit (1993), flouté comme Bruce Springsteen avec The Rising (2002), à chaque fois il s’agit pour eux de ne pas se contenter de la représentation pure et simple, mais de la contourner pour en lever toutes les ambiguïtés.

- Mick Jagger
Objet du désir et de l’attention des foules, la star se pense en centre de l’univers tout en se voulant insaisissable, secrète. Absente et présente à la fois. Phil Collins détourne les yeux, tandis que Mick Jagger nous observe et nous tourne le dos au même instant. Quant à Bruce Springsteen, son apparition fantomatique sème le trouble : est-ce bien lui qui se tient debout contre ce mur ?

- Bruce Springsteen
D’autres estiment qu’un portrait porte davantage les vertus de la vérité. Beaucoup moins moche - mais comment faire pire ? que celui de Dylan dans le bien nommé Self Portrait (cf. le logo principal de cet article), la peinture qui orne Soul of a Man d’Eric Burdon marque une nouvelle fois une prise de distance esthétique qui permet de relativiser l’approche purement égocentrique des pochettes offertes par la plupart des rockers de plus de soixante ans. A l’image des disques précédents de Ray Davies et Calvin Russell, il est question d’« homme » dans le titre, symbole de la personnification à l’extrême de cette branche éminemment nostalgique du rock. Au moins le chanteur de la mythique version de House of Rising Sun nous gratifie-t-il d’un dessin aux couleurs pastels plutôt bienvenues, douces et apaisantes, qui nous dévoilent son âme mieux que ne l’eût fait une énième photographie.

- Eric Burdon

- Robert Plant
Par ailleurs, certains profitent de l’exercice de la pochette pour se réinventer, se composer un personnage à la mesure de leur imagination. Ce qui peut donner lieu à quelques couvertures hautement ringardes, lorsque Robert Plant se rêve en barde celte à la sortie de l’album Now and Zen de 1988, ou encore quand Ringo Starr parodie un classique de la science-fiction pacifiste des années cinquante, The Day The Earth Stood Still, en récupérant une image fameuse du film pour en réactualiser le message de paix conforme aux idéaux hippies.

- Ringo Starr
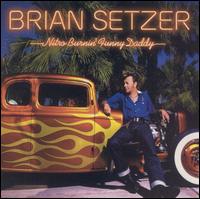
- Brian Setzer
Pour terminer, arrêtons-nous un instant sur deux objets récurrents et propres au genre. A commencer par la voiture (ou la moto), métaphore éternelle de la liberté à l’américaine, celle des grands espaces, de la vitesse et du voyage de l’esprit et du corps. Depuis ses débuts, le rock a souvent glorifié la route et la bagnole, notamment sous l’ère du surf et des Beach Boys, Brian Wilson étant un immense fan de hot rods, ces anciennes voitures customisées qui pullulent en Californie. Le rockabilly cat Brian Setzer pose ainsi devant l’un de ces modèles sur Nitro Burnin’ Funny Daddy (2003). Chez les bluesmen aussi, la voiture a désormais détrôné le train de marchandises du ramblin’ man d’autrefois. Aujourd’hui, le blues-rock s’écoute en bagnole via l’autoradio et se joue en costards si l’on en croit la photo de Riding With The King. Endimanchés, Eric Clapton et B.B. King se la coulent douce dans ce qui pourrait être une Cadillac. Voici à quoi ressemble le blues de l’an 2000.

- Eric Clapton et BB King
Le second élément qui accompagne le rocker de plus de soixante ans dans presque tous ses déplacements c’est, vous l’aurez deviné, la guitare. Dans le petit monde du "classic rock", pas un - ou presque - homme qui n’ait voulu son cliché guitare à la main ! A lui tout seul, le genre mériterait une petite étude détaillée, tant il a été décliné à toutes les sauces, pas toujours ragoûtantes hélas. Il nous faudrait des pages et des pages pour en illustrer les innombrables positions et gestuelles, depuis l’ombre de la guitare (Elvis Costello) jusqu’à la guitare raccordée (Joan Baez), en passant par la guitare toute seule (Alvin Lee) ou la guitare tenue tout connement à la main (Steve Winwood, Tony Joe White et des millions d’autres).

- Lou Reed
Bref, c’est une véritable ode à cet instrument qui s’égrène disque après disque chez les vieux de la vieille, guitar-hero ou non. Évidemment, celui qui a réussi l’une des plus belles et originales illustration de cet amour immodéré pour la six-cordes est aussi l’un de ceux qui sait le mieux la manier. Eric Clapton, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est fendu d’un petit hommage à Dali en imaginant une guitare molle à ses côtés sur la pochette de Money And Cigarettes (1983). Comme quoi les dinosaures sixties peuvent parfois se mettre en scène avec goût.

- Eric Clapton






















































Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
